n° 105
vendredi 9 août 2019
édito
Et puis un beau matin, on se retrouve sur les Champs-Élysées…
On est parti il y a tant de jours, et le but nous semblait alors presque inaccessible. On s’était « mentalisé », comme on dit aujourd’hui : cette année, c’est sûr, on ne se laisserait pas avoir. On irait, d’un atelier à l’autre, du contre-la-montre aux grands cols des Pyrénées, des Rebonds aux lectures, des premiers sprints aux grandes échappées, c’est sûr, on ne raterait rien. Et puis un beau matin, sans qu’on ait rien vu venir, on se retrouve sur les Champs-Élysées, et le Tour est terminé.

Au Banquet, cette journée de vendredi, c’est nos Champs-Élysées à nous. La caravane publicitaire s’est disloquée dans la banlieue, les derniers sachets de saucissons secs Cochonou ( » Savoir-faire, authenticité « ) ont été depuis longtemps jetés sur la foule des bordures, les pare-soleils en carton « Skoda », les dernières pochettes de Aujourd’hui Le Parisien distribuées dans les virages. Ce soir, le Banquet sera terminé.
Il reste encore à partager vers 16 heures la dernière rencontre de l’atelier cinéma : le réalisateur Alain Guiraudie, qui a l’air de se trouver à Lagrasse comme un poisson dans l’eau, conclura le séminaire que Jacques Comets et Stéphane Habib ont animé toute la semaine. À 18 heures encore, Lionel Ruffel tâchera de mettre le feu. Avec la chaleur et le temps qu’il fait, on sera très attentifs à le garder sous contrôle. À 19 heures 19, Romain Bertrand finira le grand récit du voyage de Magellan. On ne veut pas spoiler, mais ça risque de ne pas trop bien finir…
Puis viendra la soirée de clôture. Depuis une semaine, Mélanie Traversier fait travailler ses lecteurs sur un choix de textes tirés des livres du catalogue des éditions Verdier. Il nous tarde de savoir quel sera le tout dernier texte, celui qu’elle a choisi pour mettre un beau point final à tout ça. Enfin il nous tarde… Pas sûr. Parce que ça voudra dire aussi que là, pour le coup, c’est vraiment terminé.
La photo du jour

Le reportage
À l’été de 1997, Michel Séonnet et Stéphane Gatti ont animé, au Banquet du Livre de Lagrasse, un atelier vidéo, comme on disait alors, qui posait la question de savoir si la pensée est une chose qui se filme. Pendant ces tournages, ils ont interviewer Benny Lévy, qui leur raconte comment intervint, de son point de vue, la création des éditions Verdier. Quarante années plus tard, cet entretien, présenté toute cette semaine dans le cadre du Banquet dans l’exposition consacrée aux éditions Verdier, est un des plus beaux et limpides témoignages sur ce que furent, pour nous, ces années-là.
Variation 7
Par Gilles Hanus
Traduire, c’est non moins transformer que reproduire. C’est ainsi du moins que l’entendait Franz Rosenzweig dans la préface qu’il donna à sa traduction des poèmes de Jehuda Halévi. Certes, il s’agit de faire passer un texte d’une langue à l’autre, d’en changer la forme donc (si on admet que la langue est une forme) tout en restituant dans une autre langue son fond. Mais cette manière de traduire vaut pour une commande commerciale, pour un mode d’emploi où il ne s’agit que d’accéder à ce que le messsage initial dit. Il en va tout autrement dans les traductions littéraires ou philosophiques, où il ne s’agit plus seulement de faire comprendre mais de faire entendre, de saisir non seulement un message mais, dit Rosenzweig, une voix, de « restituer le timbre étranger dans son étrangeté ». Il n’y a pas seulement translation d’une langue à l’autre mais création, car tout texte cherche à dire quelque chose. Même dans sa langue, il cherche à surprendre, à dérouter, à changer la langue elle-même. Les grands textes changent la langue, la réinventent, mais jamais ne la laissent en l’état. « Il ne se peut pas vraiment qu’une langue dans laquelle s’est réellement projeté la voix de Shakespeare, d’Isaïe ou de Dante en soit restée intacte. Elle aura connu du renouveau, tout comme si avait surgi en elle un nouveau locuteur. » Conduire d’une langue à l’autre, certes, mais ce faisant renouveler profondément la langue, telle est selon Rosenzweig la tâche du traducteur.
L'autre photo du jour

Ce soir à 21 h 30, en clôture du Banquet, l’atelier Lire Verdier de Mélanie Traversier offrira un florilège de textes extraits du catalogue de la maison d’édition qui célèbre cette année son quarantième anniversaire.
Dans la cour de récréation de l’école communale de Lagrasse, les grands enfants que nous nous obstinons à demeurer apprennent à lire sous la baguette allegro cantabile de Mélanie Traversier. Ils et elles sont 24, depuis lundi, à faire cercle autour du catalogue Verdier pour offrir ce soir un bouquet de textes qui disent quarante ans d’une empreinte éditoriale dont personne, pas même les fondateurs, ne pouvait prédire l’ampleur.
Tout à l’heure, sous le grand chapiteau de l’abbaye, les lectrices et lecteurs de Mélanie Traversier éviteront à sa demande le piège grossier de l’accessoire et quand Jean-Noël fera « toc toc » à la porte de la littérature, ils et elles donneront à entendre ces mots qui font profession de nous transformer en nous invitant à vivre poétiquement le monde.
Par Serge Bonnery
Corbières-Matin année 25
Le Banquet fête cette année son vingt-cinquième anniversaire. Et Corbières-Matin avec, qui accompagna, dès 1995, les journées du Banquet. On connait l’histoire : pendant les quatre premières années, la machine à impression numérique installée dans les salles de classes de l’école communale, la rédaction effervescente, la distribution à l’aube dans tous les villages des Corbières. Il fallut ensuite attendre le numérique et ses savanes sauvages pour que l’aventure reprenne.
Pour saluer ces prémices, nous vous proposons cette année de relire quelques uns des grands articles parus dans la version papier, entre 1995 et 1998. Le 14 août 1997, dans la rubrique « Un été, des étals », consacré comme on s’en doute à l’art du marché et de la cuisine, Sabine Minard et Colette olive dressait cet éloge du veau…
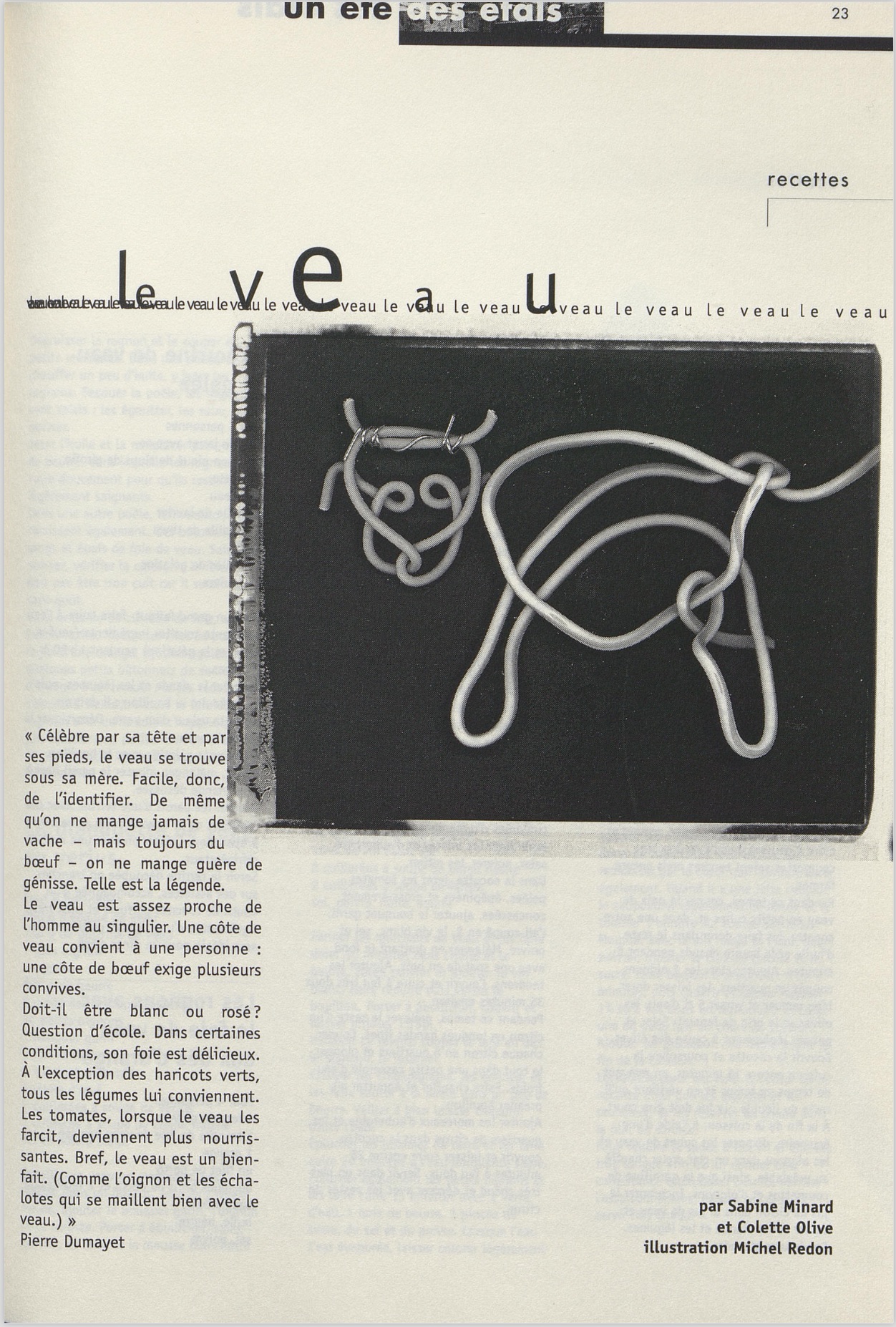
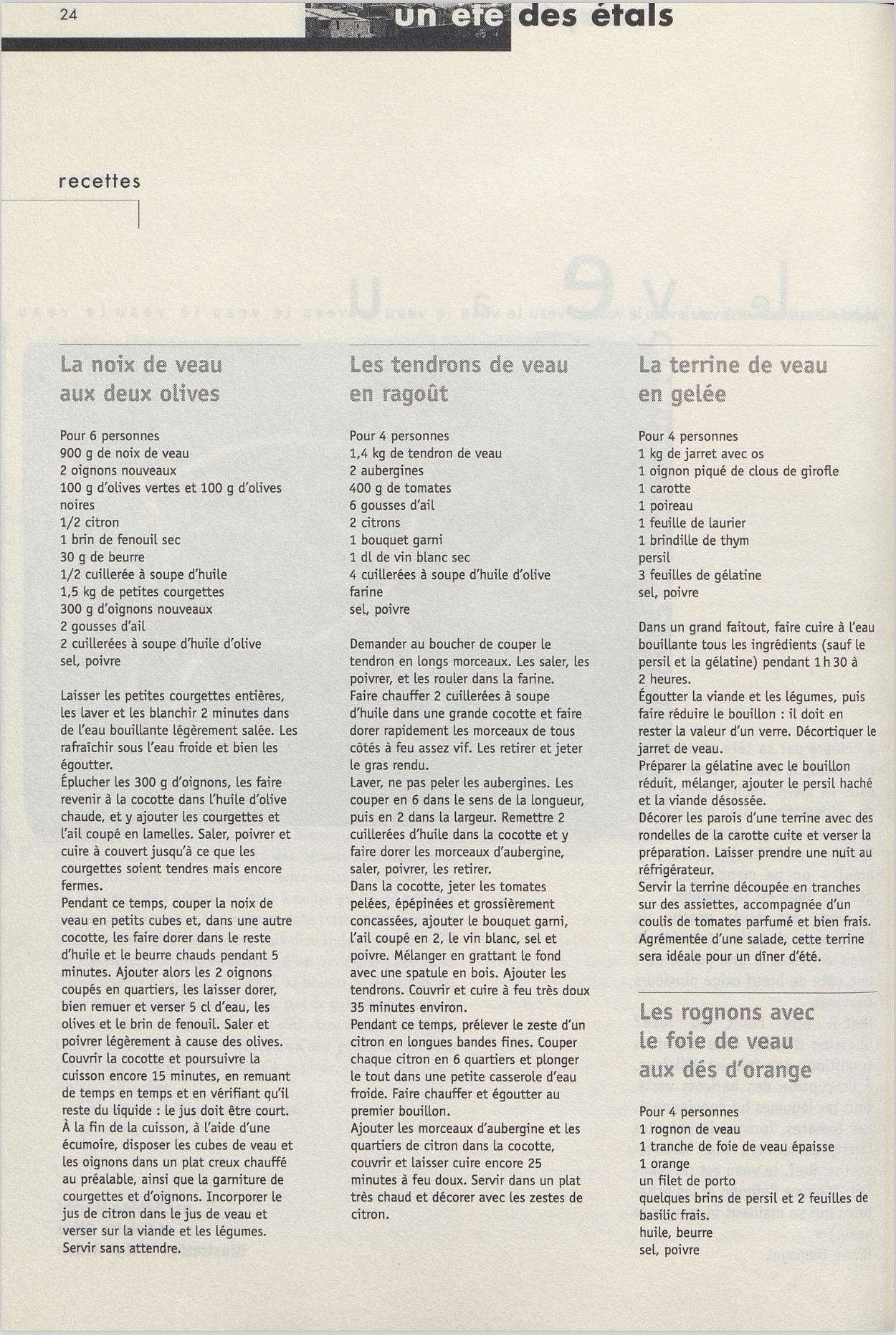
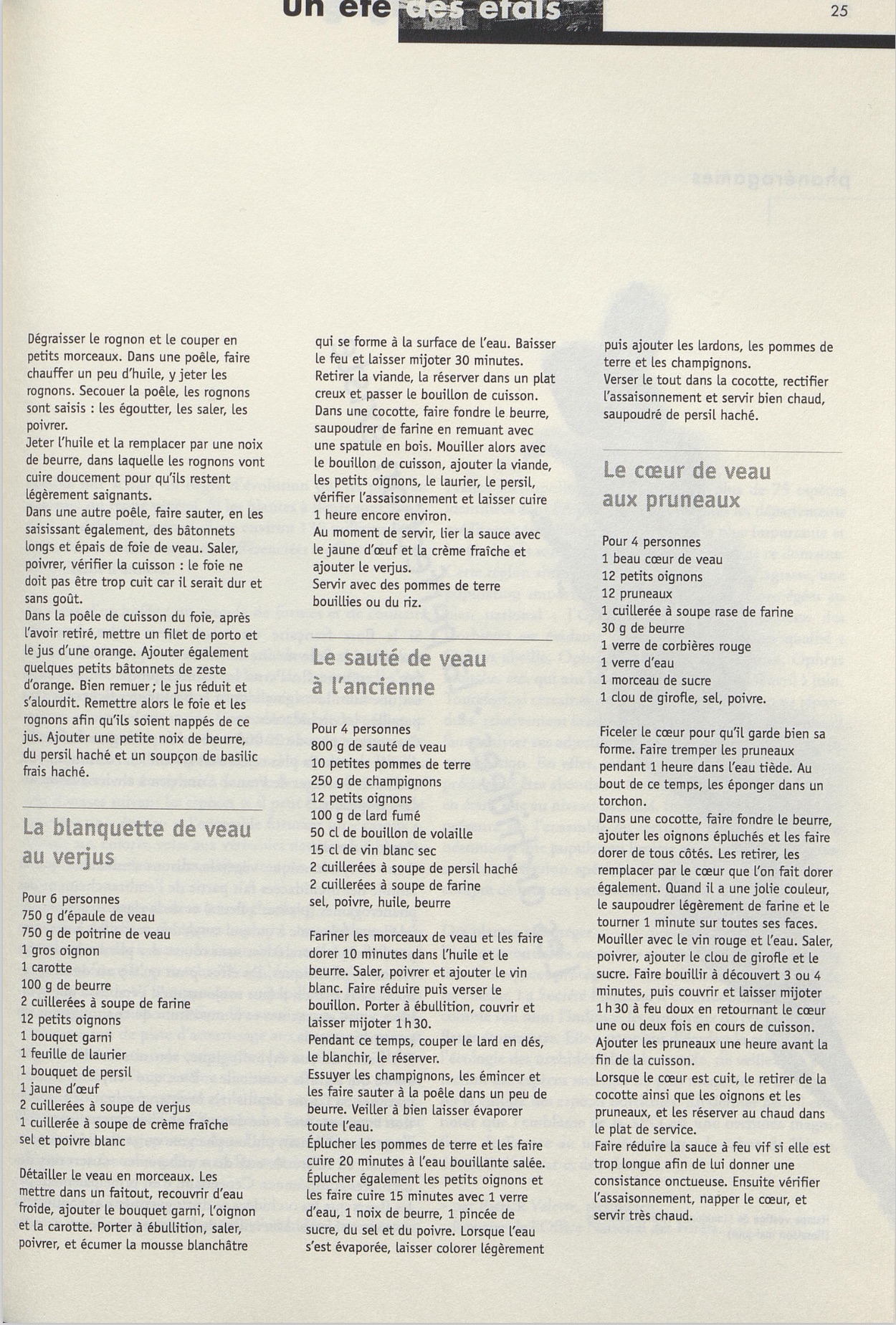
40 ans d'édition
Le Banquet célèbre cette année, avec une grande exposition, le quarantième anniversaire des éditions Verdier. En 1979, naissait ainsi, sur les bords de l’Alsou, une des maisons d’édition les plus importantes de notre époque. Le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Christian Thorel revient pour nous, toute cette semaine, sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.
8-Quelques pas vers le nouveau siècle.
Le lecteur des années 70 militait jusque dans ses lectures. Non seulement Marx et Freud étaient des bréviaires, mais on s’initiait aussi à toutes les formes des savoirs : philosophie, psychanalyse, anthropologie, sociologie, histoire, théorie littéraire. Dans toutes ces disciplines, le structuralisme est dominant. En général, la french theory est active, très active, ici et ailleurs. En Amériques surtout.
Les grandes maisons, Gallimard (qui publie Michel Foucault), Plon (qui publie Claude Levi-Strauss), Flammarion (qui publie Fernand Braudel et la collection Nouvelle Bibliothèque Scientifique), et surtout Le Seuil (on y trouve Roland Barthes, Jacques Lacan, Algirdas Greimas, Jean-Claude Milner, Tzvetan Todorov) sont les maisons qui accompagnent le mouvement. Non loin de là, les éditions de Minuit, avec Pierre Bourdieu ou Gilles Deleuze, les éditions Maspero avec Louis Althusser et un Capital de Marx revisité, en compagnie d’Etienne Balibar et de Jacques Rancière.
L’histoire et l’anthropologie se nourrissent aussi de récits, de relations : la collection Actes et Mémoires du Peuple chez Maspero, la collection Terre Humaine chez Plon, sont des lieux de beaux succès. Les Mémoires de Géronimo, les Carnets de Louis Barthas, l’Histoire de la Commune de Lissagaray, L’été grec de Jacques Lacarrière, Louons maintenant les grands hommes de James Agee, Chronique des indiens Guayaki de Pierre Clastres. Bientôt, la nouvelle direction de Fayard par Claude Durand va opérer une emprise forte et contemporaine dans les domaines de l’histoire, apportant une ouverture inattendue dans une maison jusqu’ici plutôt conservatrice dans ses approches. Dans les domaines des sciences sociales dans les années 80, il faut donc compter sur Fayard. Dans les sciences aussi, où elle enchaîne les succès avant qu’Odile Jacob, à l’initiative de la collection Le Temps des sciences, n’emporte son réseau dans la maison qu’elle crée en 1986.
Les années passent, et le public semble se détacher progressivement des sciences humaines et sociales. Du moins la génération qui suit « celle de 68 » n’attache-t-elle pas à ces savoirs le même besoin dans son rapport au monde. L’émotion prend-elle déjà le pas sur la raison ? Au Seuil, la collection Tel Quel est partie avec Sollers, les collections « vedettes » des années 60 et 70 (L’ordre philosophique, Linguistique, Le Champ freudien) fléchissent. Rue Jacob, on crée en 1990 La Couleur des idées, qui va abriter une grande part des essais de la maison, tous champs confondus. Chez Minuit, des doutes mettent en retrait philosophie et sciences, on y crée en 1991 la collection Paradoxe, bientôt lieu unique des essais, où Georges Didi-Huberman va voisiner avec Gilles Deleuze. Pierre Bourdieu abandonne les Editions de Minuit, emmène la revue Actes de la Recherche, fondée en 1975, et rejoint Le Seuil, où il publie en 1993 La Misère du monde. Le succès est immense, tout comme les livres de la collection Liber, qui prolongent la collection Le Sens commun, laquelle avait ouvert, dès les années soixante, les travaux de recherche à tous les publics. En 1995, Pierre Bourdieu, poussé par son identification publique aux idées politiques d’une gauche plus radicale que le modèle mitterrandien, et par les grandes grèves de 1995, crée la maison d’édition Raisons d’agir. Le succès considérable du livre de Serge Halimi, Les Nouveaux chiens de garde, y est un évènement. C’est aussi la relance pour Le Monde diplomatique, qui est lié en 1997 au mouvement ATTAC. Les livres d’économie politique reprennent une place inattendue sur les tables des librairies. C’est surtout le moment où de jeunes éditeurs, poussés par de nouveaux engagements et par les mouvements sociaux, entreprennent de fonder de nouvelles maisons, dans les domaines des sciences humaines et sociales.
A Marseille, les éditions Agone sont fondées en 1998 par un collectif qui anime depuis déjà sept ans la revue éponyme. Le premier livre est la réédition de Paul Nizan, Les Chiens de garde. L’essai pamphlétaire du condisciple de Sartre à Normale Sup’ fut publié par Rieder en 1932, et était dirigé contre la philosophie « embourgeoisée » de son temps, alors que son auteur était encore au PCF. Repris avec succès par Maspero en 1969, cette nouvelle édition lance une maison qui va vite compter dans le renouvellement de la critique politique et sociale, de l’histoire. Pierre Bourdieu, Jacques Bouveresse, Noam Chomsky, mais aussi George Orwell et Karl Kraus, sont parmi les auteurs réguliers du catalogue, qui s’ouvre aussi à de jeunes chercheurs dans les domaines de la sociologie et de l’économie. En 2004, le militant d’Action directe Jann-Marc Rouillan rejoint Agone, va y publier ses livres, mémoires, récits de vie, tout en trouvant un travail dans la maison, qui lui ouvre les portes dans les dernières années de sa détention. En 2002, une Histoire populaire des Etats-Unis de Howard Zinn, un livre publié en 1980 aux USA et refusé par tous les éditeurs en France, vient sauver la maison en difficultés et l’aligner sur les grands éditeurs de « SHS ». Depuis dix-sept ans, ce livre a retenu l’attention de plusieurs centaines de milliers de lecteurs. Gérard Noiriel renouvelle le phénomène en 2018 avec une Histoire populaire de la France.
Thierry Discepolo, l’un des animateurs principaux de la maison, travaille de son côté sur l’édition contemporaine. En 2011, son essai La Trahison des éditeurs fait grincer les portes de Gallimard, d’Actes-Sud et d’autres officines éditoriales. Auparavant, le thème de la trahison était pourtant cher à certains de ses aînés dans le métier, troublés par leur origine et son incompatibilité dans leur engagement politique. Ainsi de François Maspero, répondant en 1970 à Chris Marker, Je suis un bourgeois qui trahit la bourgeoisie, et toujours pour la trahir mieux. Ainsi de Jérôme Lindon, affirmant : Il existe un «bon usage de la trahison», celui qui incite l’éditeur à donner naissance aux livres que l’on n’attendait pas, et à rendre audibles les questions que l’on n’entendait pas (ou refusait d’entendre). On le constate jusque dans le sens des mots : le monde a bougé !
Gageons pourtant que la trahison dénoncée par le fondateur d’Agone reste celle d’un certain ordre culturel et du système de « reproduction », au sens de Pierre Bourdieu, qu’il produit. C’est cet ordre que d’autres vont vouloir aussi contribuer à mettre en critique, pour, eux aussi, « rendre audibles les questions que l’on n’entendait pas ». C’est ce que va faire, à partir de 1998, Eric Hazan avec La Fabrique, après son départ provoqué d’Hachette, où il dirigeait, depuis sa reprise en 1992, la maison de beaux-arts auparavant familiale, et que le groupe avait absorbée en 1992. De nombreux débats sur l’édition trouveront ici un écho dans les livres d’André Schiffrin, publiés et promus par La Fabrique, dont le célèbre L’édition sans éditeurs, essai sans concession et relation de l’expérience de Schiffrin dans le monde américain des livres, chez Pantheon Books. Des philosophes ou des historiens comme Giorgio Agamben, Jacques Rancière, Zygmunt Bauman, Frédéric Lordon, Sophie Wahnich, accompagnent l’action de la maison d’édition en y publiant régulièrement. C’est en 2007 par le livre du Comité invisible, L’insurrection qui vient, que La Fabrique fait trouver son plus grand écho aux thèses souvent qualifiées de radicales qu’elle soutient. Alain Badiou, philosophe particulièrement lu et écouté dans cette première décennie du millénaire, y publie aussi quelques-uns de ses nombreux essais. Pourtant, le soupçon pèse sur la maison, en particulier pour ses engagements envers la Palestine dans le conflit avec Israël. La Fabrique est sans concession, et l’antisionisme qu’elle promeut inspire à des intellectuels juifs et non-juifs des soupçons d’antisémitisme. Le débat sur la « question israelienne » existe depuis les premiers soutiens militants à « la cause palestinienne » dans les années 60, il est réactivé lors des conflits, en 1967, en 1973, en 1982. Les massacres de Sabra et Chatila qui mettent en cause l’armée israelienne alimenteront plus encore ce débat, avant les intifadas successives de 1993 et de 2005, et l’assassinat de Rabin en 1995, puis les arrêts des négociations. Les cent-huit numéros de la Revue d’études Palestiennes, publiée chez Minuit entre 1981 et 2008 sous la direction d’intellectuels proches de l’OLP, dont Elias Sanbar, auront à cœur de donner crédit et autorité au peuple palestinien et à son histoire. Cette longue série de publications reste à la fois un témoignage de responsabilité et le constat d’un objectif politique interrompu.
Il existe d’autres façons de s’intéresser à l’histoire, à la poésie et à la philosophie juives. Proche un temps de Verdier, avec qui il partage une diffusion commune, Michel Valensi vit entre l’Italie, Israël, Paris et le sud de la France, d’une bibliothèque à une autre. Dans cet exercice d’une diaspora personnelle, il rassemble pour les éditions de l’Eclat, qu’il fonde en 1986, et qu’il structure en collections, des livres d’auteurs souvent méconnus, comme ceux du philosophe triestin Carlo Michelstaedter, météore suicidé à 23 ans en 1910, ceux de la philosophe espagnole Maria Zambrano, ou encore de Leo Strauss, l’un des plus grands philosophes d’origine allemande, émigré en Amérique, et dont l’œuvre fait le lien entre Athènes et Jérusalem. A ces intellectuels exilés pour leur origine ou leur engagement, et auxquels s’ajoutent Walter Benjamin et son ami Gershom Scholem, l’Eclat joint des poètes et écrivains, ou des historiens juifs vivant comme Scholem en Israël. On lit, dans son catalogue de près de 500 titres, la dette intellectuelle et amicale à Giorgio Colli, éditeur en Italie de Nietzsche, ou celle à Jacques Bouveresse, dont le compagnonnage va ouvrir l’Eclat à Wittgenstein et aux américains de la philosophie analytique. Pour autant, ce travail n’ignore pas les remous du temps, et d’une modernité erratique. Des essais de Philip K.Dick, de Yona Friedman, de David Lewis, viennent leur donner des éclairages nouveaux.
La complexité du monde, la confusion dans les esprits, sont autant de déterminants partagés par des hommes et des femmes pour qui les livres sont des outils indispensables. En ce début des années 2000, les impératifs écologiques désormais évidents vont associer les techniques et les limites des progrès, et mettre le modèle économique dominant en critique. Entre 1960 et 1990, l’écologie politique a eu ses voix : René Dumont, André Gorz, Ivan Illich, Jacques Ellul, Pierre Charbonnier. C’était avant la chute du Mur, avant le monde sous Internet, avant les GAFA, mais le changement climatique est à l’œuvre et on reste sourd à ces voix. Il faut attendre le début de la deuxième décennie du millénaire pour que le voile levé par les spécialistes de la planète ne relance l’écologie humaine et l’écologie politique. Ce sera chez un bon nombre d’éditeurs indépendants tout neufs, tels que Wildproject, Rue de l’échiquier, ou les éditions Dehors. La « collapsologie » si présente désormais n’est pas tout à fait une discipline, mais les menaces sur le monde vivant et l’espèce humaine sont des éléments pour une critique de l’industrie, des modes d’énergie, des modes de vie en occident, du tout-numérique. Autant de sujets traités par une nouvelle génération de chercheurs engagés, et dispensés par ces éditeurs, mais aussi au Seuil (collection Anthropocène), chez Actes-Sud, chez Buchet-Chastel ou à La Découverte.
En attendant cette production à caractère scientifique sur l’état de notre environnement, des initiatives se sont multipliées dans l’édition d’essais, de sciences humaines et sociales. La ligne est plus philosophique chez Amsterdam, créée à Paris en 2003, et qui relaie notamment les travaux de Judith Butler, de Jonathan Israel et de Marcus Rediker, plus politique chez Lux, créée en 2002 au Québec, qui reprend des écrits de Noam Chomsky, qui fait connaître l’activiste américain David Graeber ou le militant anarchiste Normand Baillargeon. Chez les belges de Zones Sensibles, l’orientation est dirigée vers une critique construite et radicale de la technique autant que de la communication et de ses outils contemporains. Le catalogue est fait d’objets souvent singuliers, décalés dans leur discipline. On est encore surpris dans la maison du succès de Brève histoire des lignes de l’anthropologue Tim Ingold. Ce sont souvent ces succès inattendus qui font la richesse de ces nouvelles maisons, et que de grandes maisons leur jalousent. Chez Libertalia à Montreuil, un autre éditeur d’inspiration anarchiste (l’édition est à nouveau, comme dans les années 70, le lieu de nombreuses entreprises libertaires), le catalogue est plutôt composé d’auteurs du domaine public, de textes témoignant de l’histoire du mouvement, mais il abrite aussi des essais récents, tels que le pamphlet de William Blanc, Les historiens de garde, dirigé contre les succès très contestables d’historiens amateurs, tels que Lorant Deutsch ou Patrick Buisson.
L’histoire est un domaine de prédilection pour l’édition, depuis Jules Michelet et Augustin Thierry jusqu’à la Nouvelle Histoire dans les années 70, et maintenant au-delà. Après les succès de Philippe Ariès au Seuil, après les révélations sur la France de Vichy par Robert Paxton, après la Méditerranée ou L’identité de la France de Fernand Braudel, après les années de gloire de l’école des Annales chez Gallimard avec Emmanuel Le Roy-Ladurie (le public immense, inattendu, pour Montaillou, Village occitan en 1976), des médiévistes Georges Duby et Jacques Le Goff, de François Furet et de sa Révolution française, revue et corrigée au moment du Bicentenaire et objet de tant de polémiques, et après la publication luxueuse des Lieux de mémoire (dirigée par Pierre Nora de 1984 à 1992), après les succès sans cesse des biographies historiques chez Fayard, ou encore celui des travaux de Jean-Pierre Vernant et de Paul Veyne, l’Histoire avec un grand H semble faire une pause dans ce qui était son immense lectorat.
Nous sommes dans les premières années du nouveau siècle, et les incertitudes éditoriales y sont majeures. Les temps, on l’a vu, sont à la lecture d’essais plus saillants en économie politique, en sociologie, en philosophie aussi. L’histoire hésite donc, il faut aussi lui trouver de nouveaux repères et des auteurs de référence. Patrick Boucheron va incontestablement devenir l’un de ces passeurs dont la discipline a besoin pour repositionner son domaine et retrouver son amplitude. Au Banquet du Livre, on le connaît depuis 2006 déjà, et après un premier livre chez Belin, l’un des meilleurs catalogues d’histoire, paraît chez Verdier en 2008 un premier essai, Léonard et Machiavel, qui trouve un bel écho. Aussi bien en tant que nouveau directeur de la collection L’univers historique, créée par Michel Winock en 1973, collection aujourd’hui fortement renouvelée dans son fond et redevenue principale dans le paysage de langue française, qu’en tant qu’auteur (Conjurer la peur) que directeur de l’ouvrage collectif Histoire mondiale de la France, c’est avec une ténacité exemplaire que Patrick Boucheron avance avec le risque, qu’il assume, de déplaire, mais portant à nouveau l’histoire auprès du plus grand nombre, sans pour autant transiger avec le sérieux de la discipline, et dont ses aînés ont toujours fait preuve. Car publier et éditer sont aussi une affaire de dette.
Si le Seuil peut se réjouir de retrouver une première place, si Fayard se remet dans la course avec de jeunes chercheurs, c’est aussi à des maisons plus petites, plus fragiles que le lecteur et l’usager des pratiques en histoire doit de renouveler ses angles de vue. Il faut ici saluer entre autres deux maisons : Champ Vallon, avec Patrick Beaune, qui distille depuis quarante ans, en ses terres savoyardes, de la littérature, de la poésie, avec la collection Recueil, et de l’histoire. La collection Epoques, avec plus de 120 titres, y est depuis 1986 dirigée par Joel Cornette, historien moderniste réputé pour ses travaux, mais tout autant pour sa persévérance dans l’édition. Il est en effet le responsable chez Belin des treize volumes de L’Histoire de France (2009-2012) comme de la collection en cours Mondes anciens. Chez Anacharsis à Toulouse, un grand sentiment pour l’histoire, grande, petite, voire « minuscule », celle des vies des hommes, domine un catalogue de 150 titres publiés depuis 2003, que ce soit en littérature comme dans les textes classiques, traduits du grec, du latin, ou de langues orientales, que ce soit dans les légendes et autres sagas. La présence d’une Clio plus « sérieuse » est plus évidente encore dans des textes sur la piraterie, ou sur l’évolution de la Méditerranée et des confins de l’Europe, ou encore dans l’histoire trop inconnue ici de l’Amérique, celle du Nord, que l’on connaît sous le nom d’Etats-Unis. Chez Anacharsis, l’ambition est de réunir des auteurs et de constituer au plus vite un catalogue.
Un regard sur les expériences précédentes permet des décisions rapides, sur les modes de production (lancement sans attendre d’une collection de poche), sur la diffusion. Car ce souci déjà évoqué dans l’épisode précédent reste un facteur décisif dans la vie d’une maison d’édition. Distique, les PUF, qui accueillirent en leur temps quelques-unes des belles maisons évoquées, en littérature comme en sciences humaines, ont disparu ou ont abandonné cette mission. Deux entités principales restent ouvertes aux « petits, nouveaux, indépendants » : Harmonia Mundi créée en 1987, et Belles-Lettres en 1994, les deux assurant diffusion et distribution, sur un modèle qui a observé les évolutions de trois grands réseaux, Distique, Le Seuil, le CDE. Si dans l’édition, produire est une chose difficile, risquée, ces deux métiers qui conduisent les livres dans les librairies le sont tout autant. Quant à la librairie, thermomètre vivant de la santé des livres et des lecteurs, et dont nous ne parlerons pas ici, elle se réjouit de tant de propositions, tout en regrettant parfois de ne pouvoir leur donner autant d’espace que nécessaire, ni le temps long dont elles ont besoin.
Demain, ce sera le dernier épisode de cette promenade sylvestre. Nous verrons que nous sommes loin d’avoir vu tous les arbres dans cette forêt d’éditeurs, arpentée sans autre boussole que la mémoire de quelques chemins.
Bibliothèque
Dans toutes les bibliothèques du monde, dans toutes les langues du monde, les livres sont traversés par des histoires de transformation. Chaque jour, un extrait d’un de ces livres d’une de ces bibliothèques.
Julio Llamazares : « Une longue et sauvage agonie »
Ainielle, village oublié des Pyrénées aragonaises, succombe à l’exode rural qui accompagne les mutations des sociétés humaines. La misère d’un monde en voie d’extinction jette sur les routes des familles entières, en quête d’un mieux-être qui fait d’abord d’eux, et peut-être pour longtemps, des migrants et des exilés. Le dernier habitant du village refuse, lui, de partir. Il mourra ici. En attendant, il assiste « jour après jour » à « la lente progression de (la) ruine ». Pierre contre lierre, dans un « lamento infini », les maisons abandonnées cèdent tour à tour face aux forces obscures de la nature et aux illusions du réel. La bataille d’Ainielle est perdue. N’était-elle pas jouée d’avance ?
Julio Llamazarès est né en 1955 dans la province de Leon. Journaliste et écrivain, il est l’auteur de romans, d’essais et de journaux de voyage ainsi que de scenarios pour le cinéma. Quatre de ses romans sont traduits dans la collection de littérature espagnole Otra memoria des éditions Verdier, parmi lesquels La pluie jaune (traduction de Michèle Planel) d’où est extrait le texte ci-après.
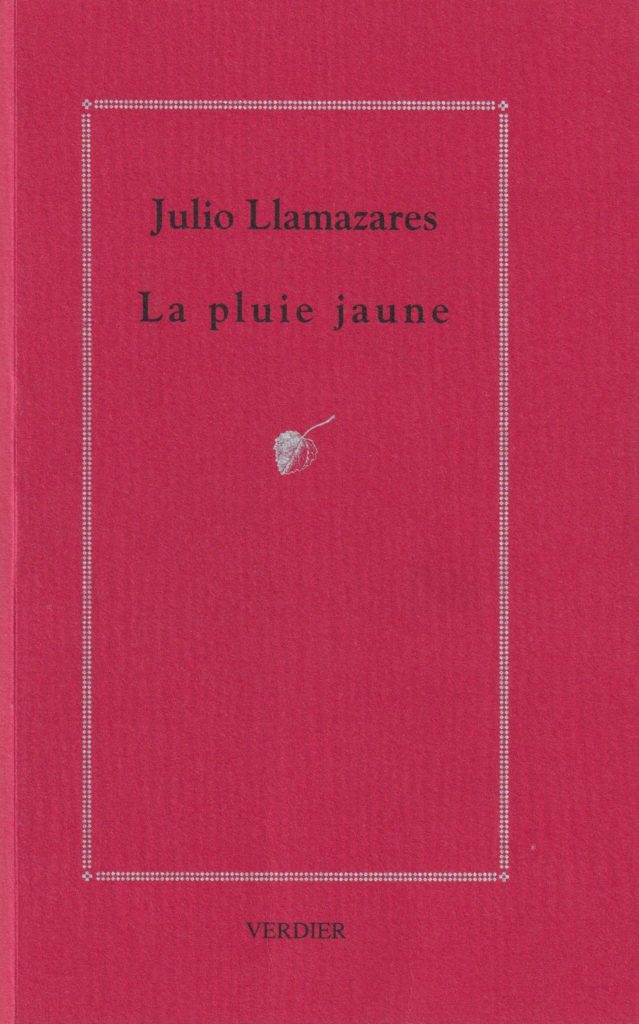 En réalité, et malgré mes efforts pour maintenir vivantes ses pierres, Ainielle est mort depuis longtemps. Il l’était déjà lorsque Sabina et moi restâmes seuls au village et avant même que meurent et s’en aillent nos derniers voisins. Pendant toutes ces années je n’ai pas voulu – ou je n’ai pas pu – me rendre compte. Pendant toutes ces années, j’ai eu du mal à accepter ce que le silence et les ruines me montraient clairement. Mais maintenant je sais qu’avec moi, seules mourront les dernières dépouilles d’un cadavre qui ne reste vivant que dans mon souvenir.
En réalité, et malgré mes efforts pour maintenir vivantes ses pierres, Ainielle est mort depuis longtemps. Il l’était déjà lorsque Sabina et moi restâmes seuls au village et avant même que meurent et s’en aillent nos derniers voisins. Pendant toutes ces années je n’ai pas voulu – ou je n’ai pas pu – me rendre compte. Pendant toutes ces années, j’ai eu du mal à accepter ce que le silence et les ruines me montraient clairement. Mais maintenant je sais qu’avec moi, seules mourront les dernières dépouilles d’un cadavre qui ne reste vivant que dans mon souvenir.
Vu des montagnes, Ainielle conserve, pourtant, l’image et les contours qu’il a toujours eus : l’écume des peupliers, les jardins près de la rivière, la solitude de ses chemins, ses cabanes, l’éclat bleu des ardoises sous la lumière de midi ou de la neige. Des rouvraies du chemin de Berbusa ou du col du mont Cantalobos, les maisons apparaissent toujours si lointaines, si disséminées et irréelles dans la poudre de la brume, que personne ne pourrait imaginer, en le découvrant dans le lointain, près de la rivière, qu’Ainielle n’est plus qu’un cimetière irrémédiablement abandonné à son destin.
Or moi, j’ai vécu jour après jour la lente progression de sa ruine. J’ai vu s’effondrer les maisons une à une et j’ai lutté en pure perte pour éviter que celle-ci ne finisse avant l’heure par devenir mon propre tombeau. Durant toutes ces années, j’ai assisté à une longue et sauvage agonie. Pendant toutes ces années j’ai été le seul témoin de la décomposition ultime d’un village qui, peut-être, était déjà mort avant même que je naisse. Et aujourd’hui, au bord de la mort et de l’oubli, résonnent encore à mes oreilles le cri des pierres ensevelies sous la mousse et le lamento infini des poutres et des portes qui pourrissent.
La première à fermer avait été celle de Juan Francisco. Cela fait bien des années, je n’étais encore qu’un petit garçon. De la maison, je me rappelle le vieux portail, les balcons de fer, le jardin où parfois nous allions nous cacher au cours de nos incursions et de nos jeux d’enfants. De la famille, seulement les yeux d’une fille. Mais je me rappelle exactement le jour où ils partirent : une après-midi du mois d’août, sur le chemin de Broto, la charrette des mules bourrée de malles et de meubles. J’étais avec mon ère au port d’Ainielle, à garder les brebis. Assis dans l’herbe nous les vîmes passer près de nous à travers les genêtières et se perdre dans le soir en direction d’Escartin. Je me souviens que mon père resta silencieux un long moment. Tournant le dos au troupeau, il regardait vers le chemin comme si d’ores et déjà il savait ce qui, à partir de ce soir-là, allait se passer. Moi, j’éprouvai tout à coup une immense tristesse et, couché dans l’herbe, je me mis à siffler.
Le départ de ceux de Casa Juan Francisco ne fut que le début d’un long et interminable adieu, le commencement d’un exode imparable que sous peu ma propre mort rendra définitif. Avec lenteur, au début, et, en fait de débandade par la suite, les habitants d’Ainielle – comme ceux de tant d’autres villages des Pyrénées – chargèrent sur leur charrette ce qu’ils purent, fermèrent à jamais les portes de leur maison et s’éloignèrent en silence à travers les sentiers et les chemins qui mènent au pays bas. On aurait dit qu’un vent étrange traversait tout à coup ces montagnes provoquant une tourmente dans chaque cœur, chaque maison. Comme si un jour, brutalement, les gens avaient relevé la tête, après tant de siècles, avaient découvert la misère dans laquelle ils vivaient et la possibilité d’y remédier ailleurs. Personne ne revint jamais. Même pas pour emporter des affaires laissées ici. Et ainsi, petit à petit, comme beaucoup de villages des environs, Ainielle se retrouva vide, solitaire et vide à jamais.
Julio Llamazarès, La pluie jaune. Traduit de l’espagnol par Michèle Planel. Editions Verdier Poche.
De Julio Llamazarès les éditions Verdier ont également publié : La rivière de l’oubli, Lune de loups et Scènes de cinéma muet.
Ils seront là pour les vendanges...
L’hiver dernier, et pour fêter le centième anniversaire de la première guerre mondiale, l’atelier de cinéma documentaire de la Maison du Banquet de Lagrasse a réalisé un film sur la vie au village pendant ce conflit : l’absence des hommes, la vie quotidienne, les premiers disparus et, à l’armistice, les chemins de mémoire jusqu’à l’érection du Monument aux morts…
Aujourd’hui, septième épisode.
SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…
![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre
FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre
![]() TWITTER : @Banquetdulivre
TWITTER : @Banquetdulivre
PROGRAMME DU VENDREDI
9h15 : Rebonds. avec Romain Bertrand (Récantou, Porte de l’eau)
10h : Muthos et logos vont en bateau. Dominique Larroque et Françoise Valon mêlent la littérature grecque et la Philosophie. (école du village)
11h30 : Entre pages. Jacques Bonnaffé, visite à voix haute entre les tables de la librairie.
12h30 : Conversations avec l’histoire. Patrick Boucheron, (sous la halle).
14h30 : Lire Verdier. Atelier lecture, avec Mélanie Traversier (complet).
15h15 : Arrêt provisoire. Lectures de Jacques Bonnaffé (sous le pont neuf).
16h : Triple voix : autour d’Alain Guiraudie et de son cinéma, avec Jacques Comets et Stéphane Habib.
17h45 : La Criée Verdier, avec Patrick Boucheron.
18h : Lionel Ruffel, L’épreuve du feu.
19h19 : Romain Bertrand, Qui a fait le tour de quoi ? : 20 mn avec Magellan. (Cour de l’abbaye)
21h30 : Verdier 40. Soirée de clôture du Banquet, par l’atelier lecture de Mélanie Traversier, un choix de textes du grand catalogue Verdier…
Mercredi 7 août, Mathieu Potte-Bonneville a donné, sous le grand chapiteau du Banquet, une impeccable soirée de lectures, au prétexte de Fantasy. En voici les images.
ARCHIVES





Crédits photos :
Idriss Bigou-Gilles, Lina Mariou, Léonie Baysse

