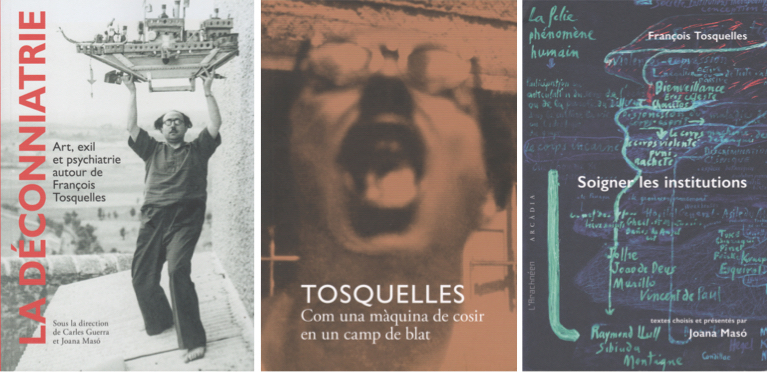Cycle Tosquelles

Avant Tosquelles
Dans L’Histoire de la folie à l’âge classique, Michel Foucault éclaire l’idée que notre conception de la folie comme « maladie mentale » est le produit de notre culture et de notre histoire. « Il ne s’agit point d’une histoire de la connaissance, mais des mouvements rudimentaires d’une expérience. (…) Faire l’histoire de la folie voudra donc dire : faire une étude structurale de l’ensemble historique – notions, institutions, mesures juridiques et policières, concepts scientifiques – qui tient captive une folie dont l’état sauvage ne peut jamais être restitué en lui-même… » Avec ce livre fondamental, Foucault ouvrait, dès le début des années soixante, un débat majeur qui allait profondément bouleverser, jusqu’à aujourd’hui, l’approche des maladies mentales. Les bases de l’antipsychiatrie naîtront sur ces travaux, et plus rien ne sera désormais comme avant.
On sait désormais que, quarante ans plus tôt, juste après les travaux et les premières publications de Sigmund Freud, les observations, intuitions et expérimentations de François Tosquelles et de tous les praticiens avec lesquels il travailla et réfléchit à partir des années 20 ont ouvert ces horizons. Jusque là, la science psychiatrique se contentait de reproduire les idées reçues et les pratiques sécuritaires du Moyen-Âge.
En 1925, le grand journaliste Albert Londres, qui vient de terminer une grande enquête aux retentissements immenses sur les bagnes français, décide d’enquêter sur les institutions réservées aux malades mentaux. Ces « asiles », créés pour la plupart tout au long du XIXe siècle, sont des lieux d’enfermement et non de soins ou de prise en charge, dans lesquels les pratiques maltraitantes sont courantes. Une loi, votée en 1838, régie ces établissements où le manque de personnels, de moyens, transforme ces asiles en lieux de souffrance psychologique et physique. « Une loi de débarras », comme l’appelle Albert Londres.
Il y a alors en France quatre-vingts établissements spécialisés dans les soins pour les aliénés. Asiles départementaux, asiles privés faisant fonctions d’hospices publics, sans compter les sanatoriums ou les villas d’hydrothérapie qui accueillent des patients aliénés.
« La loi n’a pas pour base l’idée de soigner et de guérir des hommes atteints d’une maladie mentale, mais la crainte que ces hommes inspirent à la société. »
Lors de cette plongée en immersion dans l’univers carcéral de l’époque, Albert Londres dresse un constat implacable. Locaux vétustes, absence de soins, mauvais traitements : « Les fous mangent une nourriture de baquets. Les trois-quarts des asiles sont préhistoriques, les infirmiers sont d’une rusticité alarmante, le passage à tabac est quotidien. Les asiles ont des crédits d’avant-guerre. On ne va tout de même pas faire de frais pour les loufoques ? Seuls, les asiles de Paris (Seine et Seine-et-Oise) ont de quoi aller au marché. Les autres touchent 9 fr, 7 fr, 4,65 fr par tête de fou.
Camisoles, ceintures de force, cordes coûtant moins cher que des baignoires, on ligote au lieu de baigner. »
Au début de son enquête, l’administration refuse à Albert Londres les autorisations de visite. Il cherche alors à se faire interner comme malade, pour pouvoir décrire de l’intérieur ce qui se passe derrière les hauts murs des institutions. Mais il échoue et patiemment, réussit à gagner la confiance de certains gardiens, de certains médecins, et s’assure quelques complicités pour pouvoir quand même pénétrer en catimini dans des asiles situés aux quatre coins du pays. Les moments de vie qu’il rapporte alors sont tout à fait stupéfiants.
« Au fond est la salle de Pitié. C’était inattendu et incompréhensible. Juchées sur une estrade, onze chaises étaient accrochées au mur. Onze femmes ficelées sur onze chaises. Pour quel entrepreneur d’épouvante étaient-elles « en montre » ? Cela pleurait ! Cela hurlait ! Leur buste se balançait de droite à gauche et, métronome en mouvement, semblait battre une mesure funèbre. On aurait dit de ces poupées mécaniques que les ventriloques amènent sur la scène des music-halls. Les cheveux ne tenaient plus. Les nez coulaient… La bave huilait les mentons. Des « étangs » se formaient sous les sièges. Dans quel musée préhistorique et animé étais-je tombé ? L’odeur, la vue, les cris vous mettaient du fiel aux lèvres.
Ce sont les grandes gâteuses qui ne savent plus se conduire.
Qu’on les laisse au lit !
On les attache parce que les asiles manquent de personnel.
Tout de même ! »
Ce qui trouble parfois, dans ces extraits, ce sont ces résonnances de principe avec nos scandales modernes. Mais à vrai dire, le plus souvent, en 1925, on ne sait pas trop quoi faire entre les bourgeoises déprimées et les assassins.
« C’est un paysan à l’œil pacifique.
– Pourquoi avez-vous tué votre belle-fille, Norbert ?
– Elle voulait gouverner la maison sous prétèque qu’elle avait la peau neuve. Je lui ai dit : « Ma bru, tu vas t’attirer du désagrément de ma part. » Elle m’a dit : « Vous n’êtes plus le maître, c’est ici chez moi pisque j’ai épousé le fils. » Je lui ai donné un coup de hache sur la tête, pas plus que ça. »
« Madame Gaston est une « payante ». Elle doit sortir aujourd’hui faire des achats. Sœur Agathe l’accompagnera. Voilà la sœur et la dame dans la rue. Le vent pique… On ne voit qu’un tout petit bout du nez de Mme Gaston. Le couple va bien. La Sœur pose sa main sur le bras de sa compagne et lui dit certainement : « Vous marchez trop vite. » La compagne accélère. La Sœur aussi, moi de même à vingt pas derrière.
Nous enfilons la rue Georges Clemenceau. C’est une course à fond de train. Soudain, Mme Gaston bloque les freins. Qu’elle soit bénie ! C’est la devanture d’un marchand de pipes qui nous vaut de souffler. La dame entre chez le pipier. La Sœur entre chez le pipier. J’entre chez le pipier.
– Une pipe, monsieur ? demande le pipier.
– Oh ! non, pas pour moi, dis-je.
– Faites moi voir des pipes, fait Mme Gaston.
– Pardonnez-lui, Seigneur, susurre la Sœur.
On pose une boite pleine de pipes devant Mme Gaston. Elle suce tous les bouts tour à tour, comme si c’était du zan. La Sœur la tire par la manche. Le pipier n’en pipe plus.
– Donnez-moi deux pipes, dit la dame.
– Deux ! s’exclame la Sœur.
Chez les fous, d’Albert Londres, est paru en 1999 aux éditions Le Serpent à plumes.
Verbatim

Albert Londres
Le mystère humain qu’est la folie s’épaissit dans les bâtiments pendant la nuit.
L’étonnement qui, comme une auréole, ne cesse de nimber le spectateur de la vie des fous, grandit alors, autour de lui, jusqu’à l’infini.
Les asiles deviennent des cloîtres diaboliques.
Il était onze heures du soir quand je m’amenai devant la grille de la maison départementale de cette ville du sud. Le portier dormait. C’était bien l’heure. Le directeur ronflait. Heureusement ! Seule une intelligente personne comprenant les nécessités du journalisme contemporain avait les deux yeux grands ouverts.
« Le service de garde ne manque pas dans certains cas de présenter quelques lacunes regrettables » est-il écrit dans le dernier rapport officiel. Évidemment !
Tout reposait dans la cage. Aucun pépiement. Nous nous promenions, pour l’heure, à travers les cours désertes. C’est à minuit que l’on perçoit les premiers échos du carnaval qui recommence. Mais il est des dortoirs où personne ne se réveille – où personne ne se réveille jamais, ni le jour ni la nuit. La salle de la Paille, par exemple.
Salle de la Paille ? Parce que la literie est remplacée par la paille. Les lits sont des cercueils sans couvercle. Quand l’occupant meurt, on n’aurait pas besoin de le déranger, si l’on voulait. On clouerait dessus la quatrième planche, il serait tout de suite chez lui. C’est le lot des « démences séniles ». Les familles se débarrassent volontiers de ces vieillards. Les familles riches aussi !
Le jour, les mouches légères chatouillent, en tas, l’épiderme de ces immobilisés, la nuit, les mouches étaient couchées, il ne se passe plus rien. Un décès, parfois, en silence. On ne s’en aperçoit qu’au matin. Une odeur épouvantable monte constamment comme d’un fumier humain. Requiescat in pace.
Extrait de Chez les fous, d’Albert Londres, Le Serpent à plumes, 1999