Alain Freixe
…/…
Quelque chose d’essentiel s’est bien joué le 27 mai 1918 devant Vailly dans l’Aisne. Serge Bonnery en a circonscrit sinon tous les éléments du moins tous ceux dont nous disposons aujourd’hui. Je voudrais quant à moi essayer d’ancrer cet essentiel dans son véritable lieu. Pour ce faire, prendre en considération ce qui va se passer pour Joë Bousquet dans les jours qui vont suivre ce moment où selon les mots de René Char : « Le loriot entra dans la capitale de l’aube / L’épée de son chant ferma le lit triste / Tout à jamais prit fin. ». C’était le 3 septembre 1939, jour où l’Angleterre et la France déclarèrent la guerre à l’Allemagne.
Si l’on connaît les circonstances de ce 27 mai 1918 qui, à Vailly, sur le front de l’Aisne, vit Joë Bousquet se lever face au feu allemand et tomber foudroyé par une de ces « abeilles de plomb » qui depuis trois semaines, depuis la bataille du Mont Kemmel, rôdaient invisibles autour de lui comme autour de son sort, en revanche l’on connaît moins bien cet épisode du mois de septembre 1939, au terme duquel il avouera à Jean Ballard, son ami, directeur de la revue Les Cahiers du Sud : « J’ai failli être la première victime de la guerre »[1].
Que se passa-t-il de si ouvertement dangereux durant ces premiers jours de septembre 1939?
D’abord, une chose étonnante. Le 3 septembre 1939, Joë Bousquet écrit à Maria Sire pour la consoler du départ de son mari, Pierre, des mots de grande confiance : « Vraiment, du fond du cœur, je crois que nous affrontons ce terrible moment avec de bons atouts ». Or, quelques jours après, cette même guerre va le terrasser : fermeté, confiance vont voler en éclats et il va se retrouver rejeté, épave, sur les rives mêmes de la mort : « Impossible, dit-il à Jean Ballard, d’avaler même une goutte d’eau ou de thé – vomir du feu, un réflexe dans l’œsophage qui a fait croire un instant à un ulcère, et pour compléter le tableau, le cœur qui filait », le tout accompagné, précisera-t-il à Jean Cassou, d’une « violente attaque nerveuse (…). Les phénomènes nerveux étaient les plus visibles et les plus graves (…). La maladie passée, les crises nerveuses continuaient ». Ainsi, le cours du monde, les circonstances extérieures qui renouvelaient celles des années 14 venaient de rompre les digues d’un équilibre dans lequel Joë Bousquet vivait comme à demeure : « En un mot, je n’ai pas pu supporter l’idée que cela recommençait. Je me croyais plus fort. La guerre, c’était pour moi la mort même de celui que j’avais tiré de mon cadavre ».
Quelques mois après, dès janvier 1940, alors qu’il a récupéré ses forces, Joë Bousquet s’ouvre au fait capital. Par-delà le diagnostic médical – « Gros abcès du rein faisant pression sur le diaphragme, avec tendance à la rupture des voies naturelles » – quelque chose s’impose à lui qui l’alarme et dont il va répétant l’évidence contraignante à Jean Ballard d’abord : « Mon mal de septembre m’aurait moins alarmé si je n’avais dû y reconnaître tous les traits d’une blessure »; au poète Lucien Becker ensuite : « Mon début de guerre a été hideux. Ce qui s’est passé, on le sait, maintenant, ma moelle a de nouveau saigné. Une balle invisible a touché au même endroit la plaie guérie, et je vois recommencer ma vie »; à Jean Cassou enfin : « Il a fallu comprendre que la moelle avait saigné de nouveau ».
Avec le mal nommé, avec cette nouvelle blessure qui s’incarne là-même où l’ancienne s’était refermée, il semble que Joë Bousquet comprenne que pour qu’il y ait eu répétition, il fallait que quelque chose ne se soit pas déployé, que quelque chose étant en même temps A et non-A – plaie mais plaie guérie – opère comme un blocage logique suspendant le déploiement temporel. C’est ainsi qu’il va avouer à Jean Cassou : « Depuis vingt ans, je ne comptais plus qu’avec mon immobilisation et je l’avais classée », à quoi il ajoute immédiatement comme signe de cette levée d’écrous : « Les plaies sont revenues ». C’est qu’en effet si la logique est loi formelle, le corps, lui, est loi vivante : « On ne saurait montrer d’une façon neuve que ce dont notre corps saurait être la genèse, écrira-t-il. L’esprit a besoin du corps entier pour être l’esprit même ». Ainsi lorsqu’une conclusion est suspendue, qu’un processus n’est pas arrivé à son terme, on peut comprendre qu’il y ait référence au corps comme seul garant de la continuité des processus de pensée. Alors, de même que le réel revient toujours à la même place, comme le dit Jacques Lacan, pour peu que les circonstances en favorisent le retour, de même revient la blessure que l’on avait crue classée et finalement oubliée. Rouvertes, les plaies livraient passage à la mort, dont Joë Bousquet saura toujours reconnaître qu’elle est ce qui entretient la vie.
Messagères de vie, les plaies rétablissaient la continuité. Elles laissaient affleurer à leurs lèvres le souffle du possible.
« Cette troisième vie commence bien. A vingt ans, j’ai enterré la première. Il paraît que je viens de remourir. Et je me sens renaître » Joë Bousquet
Que déclare Joë Bousquet à Jean Ballard en cette fin d’année 1939 ?
Deux choses : d’une part, « retiens, lui dit-il, qu »il n’y a plus rien de moi dans mon passé d’homme. Je suis né d’hier et j’en suis heureux » et d’autre part, « je suis intimement persuadé que ce nouvel accès est pour m’arracher à mon passé d’homme ». Ainsi commence-t-il l’année 1940 avec cette volonté : « Il faudra renaître, et renaître différent. »
Renaître, c’est éprouver que la vie n’est pas seulement rendue. Cela ne serait que guérir, c’est-à-dire retourner tel quel à un état précédent. La guérison n’est finalement qu’une réparation. Ainsi reprend-on sa vie, mais c’est toujours la même vie. Rien ne diffère vraiment.
Non. Renaître, c’est éprouver que la vie, remise comme à portée, est à construire de nouveau. Et différemment. Dans cette différence, être vrai a toute sa part.
De la fulgurance de la blessure de septembre 39, de cette remontée de lumière, il n’y a rien à dire, il n’y a pas à dire sa vérité, mais, à partir d’elle, à partir des yeux qu’elle lui donne, Joë Bousquet entend voir la vie non comme ce que nous croyons faire mais bien comme ce qui nous fait. Dès le 1 janvier 1940, il écrit à Jean Ballard : « Refuser (…) tout ce qui ne plonge pas ses racines dans la vie telle qu’elle est, nous devons purifier l’imagination, lui dit-il, en faire un instrument pour saisir la vie telle qu’elle est ; vie divinatoire pour y accéder. Car la pensée ne peut nous conduire à la vie, elle est le gage de son déséquilibre. »
Fort de cette volonté d’être vrai qu’il hérite de cet « éclair de la durée » que fut le retour de la blessure, Joë Bousquet prendra la mesure de ce tracé de nuit qu’ouvrit « l’abeille de plomb » du 27 mai 1918. Tout devenait clair. Jusqu’à sa « faute ».
En quoi consista donc cette « faute »?
Très vite, Joë Bousquet, comprit qu’il ne servait à rien de se révolter contre son sort, de jouer à l’homme bien portant, à « l’homme de type courant, dit homme-à-pattes », s’employant à oublier son mal et à le faire oublier aux autres, comme il le fit d’abord, conformément à tous les témoignages de ses amis. Ginette Augier, la dédicataire des Lettres à Ginette, me le confirmait dans une de ses lettres, en date du 30 mai 1990 : « C’est vrai, lorsque je l’ai connu, il gommait sa blessure, il jouait à ne pas m’apparaître blessé. Dans la Bugatti de son ami James Ducellier, il envisageait tous les aspects de la vie de plain-pied, comme s’il les vivait, s’il y était plongé, comme s’il y participait vraiment ». Ces années recouvrent la période de l’engagement aux côtés des surréalistes par l’intermédiaire de Gala et Paul Eluard, de la revue Chantiers (1928-1930), de son travail aux Cahiers du Sud après la mort d’André gaillard, des grands romans – de Il ne fait pas assez noir à La tisane de sarments en passant par Le rendez-vous d’un soir d’hiver et Une passante bleue et blonde (Tome I et II des œuvres romanesques complètes chez Albin Michel) période qui va s’achever d’une manière quelque peu testamentaire par « un travail de dingo », « une entreprise de liquidation » qui verra Joë Bousquet mettre au point – Courant 1938 – et publier, avant septembre 1939, trois romans importants: Le mal d’enfance et Le passeur s’est endormi qui paraîtront chez Denoël et Iris et Petite-Fumée qui paraîtra chez Guy Levis Mano, comme si cette folie d’écriture entendait en terminer avec les anciens chemins afin de se présenter, balbutiant et nu, à l’avenir dont Bousquet pressentait les coups sourds. Ces œuvres que René Nelli nomme « lucifériennes » se caractérisent, selon lui, par « le goût des mancies poétiques, des significations fatales, des systèmes de coïncidences », toutes œuvres de compensation, au cours desquelles, pourtant, il apprendra mais encore qu’il faut toujours s’accepter.
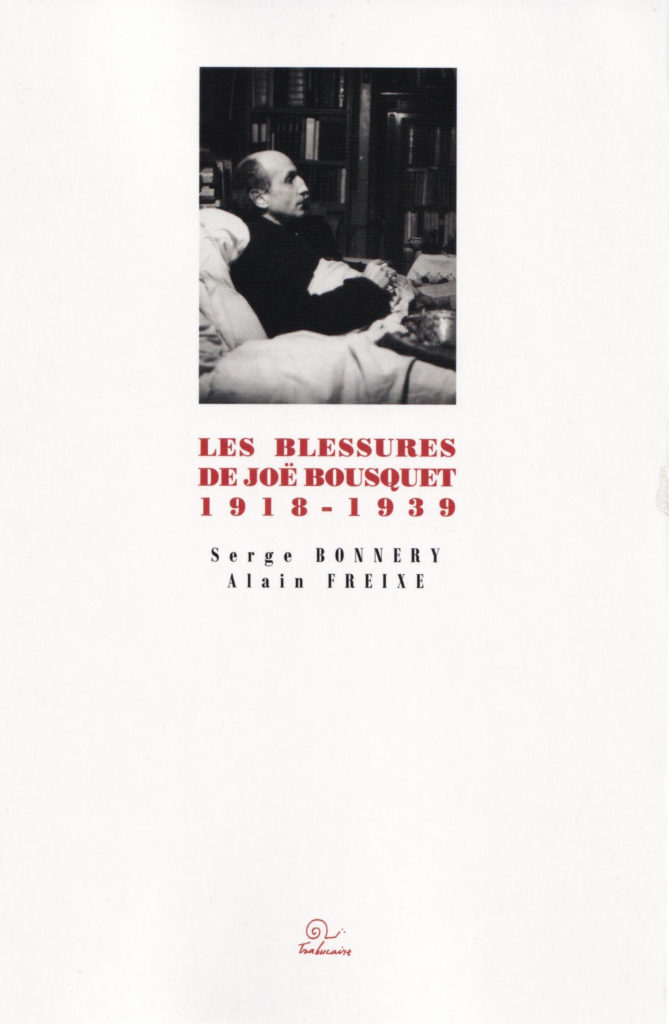 Passé sa « première méprise », selon l’expression qu’il utilise dans Le meneur de lune, il va progressivement chercher à s’accepter : « Il faut accepter. Il faut toujours accepter. Mon mal est né de ma révolte contre mon sort », dira-t-il dans Traduit du silence. Joë Bousquet nommera cet effort en se servant du verbe « naturaliser ». Il dira : « Naturaliser l’accident dont ma jeunesse a été la victime. J’ai voulu qu’il cessât de me demeurer extérieur; et que toute mon activité intellectuelle et morale en fût le prolongement nécessaire; comme si dans une existence entièrement restaurée, je pouvais effacer le caractère matériel dont il était revêtu ». On voit combien sa volonté restait encore profondément « organique ». Naturaliser, c’était réduire la blessure à ses données matérielles. C’était effondrer les plaies sur elles-mêmes. C’était s’interdire tout savoir sur l’événement dans la mesure où l’accident le couvrait toujours de sa nuit. Bref, c’était faire de la blessure « une abstraction » : « Par un travail inlassable, écrira Joë Bousquet, je me substituais un être de culture. Or, j’ai senti la faute, mais je l’ai sentie en aveugle ». Ainsi à s’accomoder de son mal-accident, il en ratait le sens-événement et il était entrain de produire une œuvre où l’idéalisme consolateur empoisonnait jusqu’au langage et où la métaphore, puisée encore dans l’espace de la représentation, restait l’absolue maîtresse. De ce danger, Joë Bousquet prenait acte, dès mars-avril 1940, quand, à propos des « mœurs littéraires à faire régner », il écrivait à Jean Ballard : « Nous condamnons les fictions quand elles sont pour endormir l’homme et le tromper sur sa condition. La littérature n’est pas faite pour aider l’homme à être ce qu’il est, elle n’est pas une valeur de remplacement ».
Passé sa « première méprise », selon l’expression qu’il utilise dans Le meneur de lune, il va progressivement chercher à s’accepter : « Il faut accepter. Il faut toujours accepter. Mon mal est né de ma révolte contre mon sort », dira-t-il dans Traduit du silence. Joë Bousquet nommera cet effort en se servant du verbe « naturaliser ». Il dira : « Naturaliser l’accident dont ma jeunesse a été la victime. J’ai voulu qu’il cessât de me demeurer extérieur; et que toute mon activité intellectuelle et morale en fût le prolongement nécessaire; comme si dans une existence entièrement restaurée, je pouvais effacer le caractère matériel dont il était revêtu ». On voit combien sa volonté restait encore profondément « organique ». Naturaliser, c’était réduire la blessure à ses données matérielles. C’était effondrer les plaies sur elles-mêmes. C’était s’interdire tout savoir sur l’événement dans la mesure où l’accident le couvrait toujours de sa nuit. Bref, c’était faire de la blessure « une abstraction » : « Par un travail inlassable, écrira Joë Bousquet, je me substituais un être de culture. Or, j’ai senti la faute, mais je l’ai sentie en aveugle ». Ainsi à s’accomoder de son mal-accident, il en ratait le sens-événement et il était entrain de produire une œuvre où l’idéalisme consolateur empoisonnait jusqu’au langage et où la métaphore, puisée encore dans l’espace de la représentation, restait l’absolue maîtresse. De ce danger, Joë Bousquet prenait acte, dès mars-avril 1940, quand, à propos des « mœurs littéraires à faire régner », il écrivait à Jean Ballard : « Nous condamnons les fictions quand elles sont pour endormir l’homme et le tromper sur sa condition. La littérature n’est pas faite pour aider l’homme à être ce qu’il est, elle n’est pas une valeur de remplacement ».
Ainsi ce qui fulgura en septembre 1939, d’une part arracha Bousquet à l’homme révolté contre son sort comme à l’homme résigné qui « s’interdit de voir plus loin que la vie mortelle », à toutes les figures du ressentiment qui veut toujours attribuer ce qui arrive à quelqu’un, voire à quelque instance supérieure, et qui dans les gémissements de ses plaintes, dans ses cris de révolte, dans sa douceâtre résignation n’est qu’une forme d’empoisonnement par la pensée abstraite et la volonté mauvaise. « N’aie pas de rancune, dira Joë Bousquet, la rancune est un sentiment si inférieur qu’elle ne distingue pas entre la vie et la mort ». Et d’autre part, l’arrachant à ce monde où l’on cherche toujours à transiger avec son mal, de tentatives de maîtrise en accomodations, ce retour des maux qui le brisèrent donna un tour à sa volonté qui, d’ « organique », n’ayant à faire qu’à ce qui arrive comme à un fait brut, a longtemps travaillé à l’oublier, vira en une « volonté spirituelle » qui dans le fait brut va s’efforcer de dégager « la part de l’événement que son accomplissement ne peut réaliser », selon Maurice Blanchot, c’est-à-dire ce qui ne s’épuise pas dans la terrible effectuation corporelle.
« Le premier acte de liberté, c’est de vouloir ce que nous sommes, de l’aimer, de lui donner son poids de vie dans le passé » Joë Bousquet
Nous sommes à nouveau à un tournant. Le même que celui qu’offrit la blessure de mai 1918. L’éclair de septembre 1939 illumine les terres nouvelles d’une ascèse morale qui voit Joë Bousquet s’engager dans l’ »entreprise difficile, dira-t-il, de faire avec mon cœur le cœur de ma vie, de ne plus distinguer de ma volonté mon destin ». Désormais, il n’y aura plus pour lui d’œuvre littéraire digne de ce nom, c’est-à-dire capable de faire œuvre de vie, si la personne morale ne s’y trouve engagée.
J’appelle « tourne » cette « expérience cruciale ». Tourne, il faut entendre ce mot dans le sens qu’il avait au XVIIIème et que met en lumière Alain Rey dans son Dictionnaire historique de la langue française à savoir « ce qui est dû au tournant », acte de la volonté qui veut ce que propose le tournant.
Parce qu’il lui révéla qu’il y va de la hauteur véritable de l’homme – hauteur inévaluable -, de sa dignité, de sa chance d’être un homme puisqu' »un homme n’est pas digne de son nom tant qu’il voit dans la vie qui lui est faite une forme de l’adversité », parce qu’il lui imposa la blessure comme vie, triomphant par là de cette difficulté qu’il avoue en ces termes : « La difficulté pour moi avait été de me souvenir et non d’oublier que j’avais été blessé », parce qu’il fit tourner son vouloir : « Je ne ferai plus languir, écrira-t-il, à ce qui est l’assentiment de mon vouloir, l’éclair de septembre 1939 va engager Joë Bousquet à vouloir cela même qui le jeta parmi les morts.
Que veut dire, pour lui, vouloir la blessure ?
Vouloir la blessure, c’est d’abord vouloir y porter son amour : « aimer ma blessure, dit-il, et y reconnaître un bienfait », car « il est des faits que nous avons vécus et qui nous pressent, non de les reconnaître, mais de les croire. Il faut que l’homme ajoute foi aux événements qui sont passés sur lui et qu’il les personnifie en adhérant à eux pour toujours ».
Vouloir la blessure, c’est ensuite vouloir en dégager l’événement. Cela suppose de ne plus la réduire à l’accident où elle s’est matérialisée, et donc la dédoubler, l’ouvrir : « Sous sa forme initiale, écrira Joë Bousquet, elle était un fait divers, la lésion d’un individu, la diminution infligée à celui qui n’était rien. C’est le génie des hommes d’en tirer un événement. » Cette partition, Bousquet la nommera différemment dans ses textes. Ainsi dans Traduit du silence, il opposera le sens que présente la blessure pour la pensée à celui qu’elle peut avoir pour le cœur ; dans Mystique, il dira : « Nous ne lisons dans un fait que son contenu manifeste, nous méconnaissons qu’il est la conscience d’une vie où nous sommes à peine des ombres ».
Vouloir la blessure comme événement, c’est vouloir dans ce que le corps a reçu un 27 mai 1918, dans ce malheur, la part immaculée, sa « perfection » et son « éclat », cette vérité éternelle qui est là à attendre et à faire signe, vérité où « ma destinée se lit au grand jour », écrira-t-il.
Vouloir la blessure comme événement, c’est pour Joë Bousquet entrer dans sa blessure par le côté ensoleillé de sa personne, entrer dans la vie du cœur où l’attend cet « être aîné, responsable de tout ce que nous fûmes ». C’est cet « être aîné » qui va devenir le garant du fait qu' »il n’y a pas d’épreuve imméritée » pour Joë Bousquet et que « ne nous sont vraiment advenus que les événements que nous étions capables de souhaiter ». « Tu t’es voulu tel que tu es, écrira Joë Bousquet. C’est un marché avec l’absolu dont ton existence doit payer le prix », lui intimant cet ordre : « Deviens l’homme de tes malheurs, apprends à en incarner la perfection et l’éclat ».
« Ta blessure n’est pas ton attribut. Tu es l’attribut de ta blessure. » Joë Bousquet
Vouloir la blessure comme événement, c’est quitter le monde où la blessure a un sens pour entrer dans celui où elle est sens. L’événement fonde un devoir, éveille une responsabilité à partir, on le voit, d’une dé-location de l’homme puisque celui-ci n’est plus l’auteur mais le produit des faits de sa vie : dé-personnalisation ouvrant seule au véritable sens de l’existence
Vouloir l’événement, c’est toujours vouloir la dé-prise de soi, laquelle engage un devenir autre du sujet : » Les événements parlent à un homme de son âme et il ne les entend parler que de son avenir ou bien de son passé (…) On croit que les faits disent hier, qu’ils disent demain; ils disent ailleurs, ils disent : loin de ce qui t’enfermait… » Ils disent un devenir. Ce devenir ne concerne donc que le sens que l’événement a pour l’âme et non celui qu’il peut avoir pour le moi, ce lieu des habitudes, puisqu’il ne s’agit pas de paraphraser le fait mais de le retourner vers le ciel où il est engagé dans « un devenir en lui-même qui ne cesse à la fois de nous attendre et de nous précéder », dira Gilles Deleuze dans La logique du sens. Ainsi peut-on dire de l’événement qu’il n’arrive jamais au sujet, ce dont Joë Bousquet prend acte lorsqu’il dit : « Je n’étais pas le sujet mais la manifestation de l’événement qui m’atteignait ». Aussi s’il n’est pas le sujet de ce qui lui advient, l’homme en est alors l’objet. Peut-on comprendre le « tu es une blessure et tu n’es pas un blessé » de Joë Bousquet, sans prendre toute la mesure de ce dé-centrement que subit le verbe être?
Je ne suis pas blessé, dit Bousquet – Homme dont l’attribut est la blessure – mais je suis la blessure, mieux la blessure est je – Blessure dont l’attribut est l’homme que je suis. L’attribut n’est plus rapporté au sujet mais c’est le sujet qui se trouve rapporté à l’attribut. L’attribut devient sujet et le sujet devient attribut. Alors « mon mal devient mon être et j’en suis l’accident ». Ainsi dé-stabilisé, ouvert et comme retourné, le verbe être cède le pas au verbe devenir.
N’être, c’est alors naître !
« C’est la nature de l’homme qui est son étoile : son être contient son devenir. » Joë Bousquet
Premier à L’Être, pourrait-on dire, l’événement ouvre l’être sur un devenir : « La fonction être, écrit Bousquet, se prolonge par la fonction créer ». Vouloir l’événement, c’est donc s’engager dans un devenir-blessure : « J’avais été blessé, je devenais déjà ma blessure ».
Ce devenir-blessure fait de Joë Bousquet le fils de l’événement et non plus de sa naissance au point qu’il pourra dire : « Ma mère ne me reconnaîtra plus, maintenant que ma blessure est entrée dans mon cœur ». Qui entre dans la vie de son âme n’est plus dans celle de son moi, celui-là fait cortège à ses sources et peut affirmer : « Je ne suis pas dans ma vie, mais dans le jour moral qui se lève sur elle, entièrement libre des accidents qui l’éprouvent. Je ne suis que le berceau de l’homme que je fus, que je deviens. Ainsi n’y-a-t-il qu’une loi pour mon devenir et pour son bonheur ». Cet homme qu’il fut et qu’il devient n’est pas l’individu, le moi de la conscience psychologique auquel le bruit de chaîne de l’espace et du temps donne quelque coloration de vraisemblance et qu’absurdement nous nous acharnons à prolonger, puisqu’on l’a vu, vouloir l’événement, c’est, d’une part, s’affranchir de lui, l’annuler et non le sauver car « il n’est pas », dit Bousquet, et d’autre part, dans ce renvoi même, donner naissance – comme on donne chance – à cet « être aîné », cet « être de toujours », « celui que nous avons été et qui dure à travers nous », celui-là même qui « nous fait et s’égale à ces événements qui nous épouvantent par trop nous ressembler », celui-là qui « vient des sources mêmes de notre vie », à propos duquel Bousquet ajoute : « Notre être authentique est toujours à venir. Car, né avec nous, nous n’avons jamais été lui pleinement », celui-là qui a à être et nous attend au terme de notre vie car « la vie est vérité. Traversée jamais achevée au terme de laquelle on reçoit son être véritable ». Le devoir apparaît bien ici comme la condition et la matrice même de l’être.
Si « l’homme n’est pas le sujet mais l’objet de ce qui lui advient », en revanche voulant l’événement, Joë Bousquet sait quel objet il est. Sachant cela, il redevient sujet engagé dans un devenir-blessure qui est le salut même de la blessure et l’entrée de la mort dans la mort, le triomphe de la vie, l’apothéose de la volonté, car « commémorer dans son âme l’acte par lequel il avait joué sur son âme les destinées de son corps », cela libère l’événement des douleurs de l’accident, de l’engluement dans l’effectuation, le rendant disponible pour d’autres fois : « Je vivrais jusqu’à ma dernière heure l’instant de ma blessure ou plutôt l’instant où j’acceptai ma blessure ». Gilles Deleuze appelle cela « contre-effectuer » l’événement.
Cet acte de contre-effectuation seul est apte à sauver la part immaculée, éternelle, passée et toujours à venir, de l’événement en l’empêchant de se confondre avec son inévitable effectuation. C’est pourquoi c’est dans cette contre-effectuation que réside tout le devoir de celui qui entend se montrer digne de ce qui arrive et donner toute la hauteur d’un homme à ce qui n’étaient que plaies brutes : « Nous devons, écrit Gilles Deleuze, doubler cette effectuation douloureuse par une contre-effectuation qui la limite, la joue, la transfigure. Il faut s’accompagner soi-même ».
« Différent de mes amis parisiens, je viens de l’écrivain, je vais vers l’homme. Je détrônerai le style. Mon don poétique servira le réel, non la fiction. » Joë Bousquet
Cette contre-effectuation, c’est l’écriture qui la prend en charge. Joë Bousquet ne donnait pas d’autre définition à la poésie que d’être « cet accueil qu’un homme fait à sa vie ». Plus que poète, il devient en cela un « être de poésie ».
On a vu comment ce « cœur majeur » fut menacé d’étouffement alors qu’il tentait de s’imposer à sa blessure, exténuant dans une idée de soi cette chair souffrante à laquelle il était voué, risquant de devenir un de ces idéalistes abhorrés. Il serait alors devenu un de ces « êtres abstraits » qui aurait produit une œuvre « qui n’aurait été qu’une sorte de songe poursuivi au-dessus de son lit d’infirme » et qui « se fût, désincarnée et insituable, coupée de son origine vraie, réduite d’elle-même à une fonction de simple prétexte ». Il l’avoue à Ginette, dans une lettre sans date mais postérieure à 1944 : après avoir évoqué ce moment initial où « (il) était pur alors (…) sans ambition littéraire », il déclare : « Puis, la vie littéraire est venue me prendre, j’ai un peu cédé (…) j’ai eu des mouvements de vanité, j’ai cru un peu en moi, j’ai joué à l’écrivain ». Ecrire était alors pour Joë Bousquet, non une contre-effectuation, mais, selon les termes de Gilles Deleuze, « une manière de se re-territorialiser, de se conformer à un code d’énoncés dominants, à un territoires de choses établies ».
C’est à cela que l’arrache l’expérience douloureuse de septembre 1939, à cela qu’il trouvait « de plus en plus froissant dans l’activité littéraire, l’obligation d’arracher à la vie ce qui en devrait (…) former la plus pure espèce, l’horreur d’écrire et de consigner nos aspirations, au lieu d’entrer en elles du même mouvement qui fait l’oubli sur nous ». Engagé dans le vouloir l’événement, dans la contre-effectuation du devenir-blessure, Joë Bousquet écrira désormais pour agrandir son âme, c’est-à-dire pour la rendre plus présente, dans la mesure où l’acte d’écrire sera, pour lui, « une révélation que l’on se fait à soi-même, une révélation métamorphosante ». Ce devenir-blessure est « la révolte de l’homme de Midi qui veut être la chair de son chant et, comme André Gaillard l’écrivait, n’élève en lui l’écrivain qu’avec l’obscur dessein de le tuer un jour ».
Parce que « l’aventure littéraire concerne uniquement la conscience morale » et parce que « la France crève de l’idéalisme de ses écrivains. J’appelle idéalisme, poursuit Joë Bousquet, la déformation de celui qui porte dans l’observation des faits une idée préconçue de ce qu’ils devraient être », il n’y a, d’une part, aucun devenir écrivain chez lui – A ce sujet, les affirmations abondent : « Je me suis indifférent en tant qu’écrivain », « Mon entreprise n’est pas celle d’un écrivain », « Il écrit mais écrivain il l’est à peine » – et d’autre part, la dénonciation incessante de la littérature qu’il est né, dit-il, pour condamner.
S’il hait et méprise « les fourriers littéraires du désespoir » qui acceptent « la condition humaine, inférieure à elle-même, comme ils l’ont reçue et s’opposent, par cette adhésion, à tout espoir de libération ou de progrès », il déteste tout autant les faiseurs de récit qui offrent aux hommes la littérature comme valeur de remplacement, histoire de les aider à supporter la vie. Pour lui, « écrire est une escroquerie » quand les écrits sont enfantés par des écrits, quand la poésie se nourrit de pensée : « en ne prenant pas dans leur vie les thèmes de leurs œuvres, écrit Bousquet, les hommes (…) escamotent le but véritable de l’art. »
A la question « pourquoi écris-tu? », Joë Bousquet préfère celle de « contre qui écris-tu? ». Sa réponse est sévère : « contre tous ces maudits de la littérature qui font servir le langage du cœur à habiller des aïeux empaillés ».
Ainsi de la blessure, fait qu’apporta la vie, Joë Bousquet sut faire un événement qui apporte la vie et la poésie ne devient le rachat du réel par le langage qu’à la condition d’aller chercher ce langage là où il est : sur les lèvres des hommes car le langage vient de la vie, de la vie qui se fait et non du langage lui-même ou de la vie toute faite.
Qu’on y prenne garde, cette condamnation n’est pas l’œuvre du ressentiment, elle est prononcée au nom de la vie que la littérature devrait accueillir et dont elle devrait rendre les richesses. Il entendait que la littérature brise « l’obstacle qui sépare l’homme qui pense de l’homme qui vit ». L’activité littéraire, il la comprenait ainsi : « changer sa vie, la purifier de tout ce que nous lui avions ajouté, lui restituer sa fraîcheur d’avant le jour, comme pour n’y sentir que la grâce et le don, et, rendus ainsi à une espèce d’innocence, communiquer notre bonheur et montrer qu’il ressemble à celui du rêve, tu sais que j’ai pris ce parti… » confie-t-il à Jean Ballard.
« Nous écrivons pour faire œuvre de vie. Purifier la vie du trouble que notre être lui apporte en la soumettant à son idée de la mort. » Joë Bousquet
Que l’on prenne garde à ces paroles de Joë Bousquet afin de ne pas l’enfermer dans une expérience spirituelle dont on vanterait la grandeur tout en la réduisant à « l’individu Bousquet » : « Ecrire, c’est d’abord avoir le sens d’autrui. On n’écrit pas pour apparaître aux hommes, mais pour faire apparaître en eux sa pensée ».
Ce sens d’autrui, puisqu’il ne saurait consister à donner du rêve à consommer, loin de toute consolation, est une entreprise de libération. Les affirmations de Joë Bousquet sur ce thème sont si nombreuses, que nous n’en citerons que quelques-unes : « Il faut libérer l’homme, lui donner son moi à créer pour libérer ses forces créatrices », « il faut délivrer l’homme de l’écœurement, briser cette nef de mirages qui à toutes ses paroles renvoie un écho de néant ». La justification d’un tel impératif – « Ah! Je vous libérerai ! » s’exclame Joë Bousquet – tient au fait que, dans cette entreprise de vérité, l’homme qu’il devient est le gage de son œuvre dans la mesure où il n’est pas le fils de celle-ci puisqu’au contraire, c’est elle qui est produite par le fils de l’événement.
Vouloir l’événement a permis à Joë Bousquet de s’unir avec son aventure et de découvrir qu’il y avait là, dans ce destin particulier, une vérité universelle : « Je dois à ma blessure d’avoir appris que tous les hommes étaient blessés comme moi ». Ainsi devenait-il tous les hommes et « le particulier était en lui la source de l’événement ».
Or, que l’homme soit une « créature mutilée », voilà ce qu’il découvre et que les hommes ignorent : « L’homme est un anesthésié. Il se refuse à la vie dont les signes l’environnent et ne sent même pas ce refus. Croit-il entrer dans son être en s’exceptant de tout ce qui à l’être donne sens? ». Il l’ignore d’autant plus que Joë Bousquet lui-même, on l’a vu, l’a méconnu longtemps alors qu’il en portait la vérité inscrite dans son corps même; que, de plus, il a reconnu, dans cette méconnaissance, la source même de son malheur.
Si tout homme est blessé, c’est qu’il est séparé de lui-même, donc du monde. Ainsi vit-il « hors de tout et hors de lui-même ». Cette blessure, il l’oublie dans ses pensées, ce qui explique qu’il « consomme une énorme part de rêve afin de se rendre supportable l’idée de la mort ». L’homme fuit son être dans ses pensées – mauvaise fuite! – et n’est que ce qu’il pense avant d’être ce qu’il est. A persévérer dans cette existence de peu où il se donne l’illusion d’être un moi, ombre qu’il vêt, embellit d’une apparence d’être, il se perd, croyant se sauver, il s’emprisonne dans des faits à qui il interdit tout rayonnement. C’est qu’en effet, il rabat la part immaculée de tout événement, la réalité spirituelle de tout fait sur les données matérielles de ce qui lui arrive. A peine reçoit-il les faits qu’il s’empresse de les définir. Or, dans le monde de la causalité, l’homme n’est jamais avare de bonnes raisons. Par là il explique et réduit tout ce qui lui vient de la vie au travers de rationalisations qui ne sont que masques dans la vie. Ainsi la pensée stérilise les choses, fane les faits, dissout tout ce qui lui advient. Momifiant le monde, elle fait barrage à la vie. Ce chemin qui va de la pensée à la vie ne mène nulle part. Ce cul-de-sac, ouvert par la peur de la mort, ne débouche que sur une peur de la vie, ou ce qui revient au même, il ne mène qu’à désespérer de ce monde-ci. Or, « c’est à crever de rire! » s’exclame Joë Bousquet avant d’accuser : « Infirmes que vous êtes! Vous avez fait votre regard prisonnier : vous l’avez séparé de ses sources et de son horizon. Vous l’avez pris au filet de la pensée que vous étiez quelqu’un ». L’effet de cette blessure niée se révèle ainsi dans un certain regard porté sur l’événement qui consiste à ne voir en lui « rien de plus que les causes matérielles qui permettaient de le prévoir ».
On comprend qu’à partir de son devenir-blessure, Joë Bousquet ait voulu réhabiliter, aux yeux des hommes, l’événement. Qu’on me permette, à ce propos, de citer un peu longuement une lettre du 29 juillet 1944 à Jean Ballard : « Dans ma dernière lettre, j’insistais sur l’accord providentiel qui vous donnait le goût des textes concrets, vécus et créateurs de vie quand j’entrevoyais de mon côté les moyens philosophiques de réhabiliter l’événement, le fait, l’anecdote, d’accuser, en ce qui les concerne, la grande misère de la philosophie qui, d’Aristote à Blondel même, par sa position homocentrique, est forcée de les disqualifier, de les définir comme une conjonction de hasards, de renoncer en somme à les définir. Sans doute était-ce bien que Blondel restaurât le caractère ontologique de l’acte, mais il était peut-être réservé à notre temps de faire un pas de plus, d’apprendre que le réel et la vie avaient leurs capitales, moins dans les idées et dans les actes que dans les faits eux-mêmes, dans ces éclairs de la durée où l’homme a part et qu’il croit avoir voulus. Sans doute cette vérité est-elle abordable par bien des biais : c’est, d’abord, l’intuition, dans un homme, qu’il est, non l’auteur mais le produit des faits cardinaux de sa vie, que, blessé, il est le sang de sa blessure… »
Réhabiliter les faits, ces « éclairs de la durée », leur donner langue, c’était, d’une part, « torpiller (…) tout ce qu’on a pensé de la personne et de ses ressources » et, d’autre part, « par des moyens poétiques, rendre à la personne l’épaisseur de toute sa vie ».
« Ecrire fort, dur, en phrases crachées. Il faut que mes paroles marquent sur la vie des hommes, et non sur leurs pensées », ce programme, Joë Bousquet pouvait le tenir car, en entrant dans sa vie, il avait fait d’elle « un langage fait pour dicter de la vie ».
Si « la vie est un scandale pour la raison », c’est dans la mesure où elle nous advient, imprévisible, indivisible et irréversible, au point que Joë Bousquet déclarera : « douter d’elle, c’est la tuer, mais croire, c’est la rendre bien plus forte que ses manifestations et ses effets ». Ainsi les faits n’ont pas à recevoir de nous une définition, ce qui est tuer la vie d’où ils viennent. Non, les faits nous définissent, c’est pourquoi les traduire, ce sera faire œuvre de vie. Tâche même de la poésie.
« Sois naissance toujours » Joë Bousquet
Telle est la tourne: elle engage Bousquet sur le chemin où il pourra « prendre la taille d’un homme », soit tenir dans ses mains cette chance d’être un homme car « un homme n’est pas digne de son nom tant qu’il voit dans la vie qui lui est faite une forme de l’adversité ». On l’imagine aisément: cela ne se fait pas en une fois : « Il a fallu longtemps pour que le courage me vienne d’aimer ma blessure et d’y reconnaître un bienfait. »
Ne plus vouloir que la blessure soit en lui mais vouloir être dans sa blessure, Ce que j’ai appelé une tourne est celle-là même de la morale dont tout le monde sait depuis Sophocle et son Antigone qu’elle se moque de la morale, celle dont Bousquet disait qu’elle était la ressource de ceux qui n’y voyaient pas bien, « morale dure, âpre, dit Bousquet dans sa Confession spirituelle de 1948, elle nous impose comme seul principe d’existence entière le fait qui nous advient, quel qu’il soit; tient que, seul, cet événement est réel et qu’il nous appartient d’en accomplir la perfection et l’éclat (je n’ai pas dit d’en incarner l’éclat, ce serait absurde!) ».
Tourne, le mot dit le tour, la tournure, une manière de s’engager dans un chemin, un passage donc. Passage qui est susceptible de se décliner de bien des manières. En voici quelques unes.
Premier passage : la tourne engage d’abord à quitter le monde de la représentation, de la connaissance et de la pensée, pour entrer dans celui de la croyance et de la vie, car « celui qui croit en la signification de la vie, celui-là n’a rien à souhaiter que ce qui est. Il met son imagination au service de ce qui est ».
Deuxième passage : la tourne fait passer d’un monde où la blessure a un sens pour la pensée à un monde où elle est sens pour la vie.
Troisième passage : La tourne fait passer d’un monde où la pensée tente d’en dire la vérité à un monde où elle est la vérité, soit cela qui n’est pas à connaître finalement puisque c’est cela même qui nous assure de tout connaître, qui nous donne les yeux pour voir la vie non plus comme ce que nous faisons mais comme ce qui nous fait.
Quatrième passage : la tourne fait passer d’un monde où les faits recevaient de nous leur définition – ce qui était tuer la vie d’où ils venaient! – à un monde où ce sont les faits qui nous définissent, et donc passer d’un monde où l’homme se croit imaginairement l’auteur de sa vie à un monde où il n’est plus que le produit des faits cardinaux de sa vie;
Cinquième passage : la tourne fait passer d’un monde où l’on n’a affaire qu’à des accidents qui nous affectent à un monde où l’on à affaire à des événements qui nous engendrent.
Premier à l’être, l’événement ouvre sur un devenir, et donc sur une responsabilité. La tourne, on le voit, fonde son entreprise de vérité et sa morale, celle où la volonté est appelée à « commémorer l’engagement d’un homme qui s’accepte » et donc à vouloir de nouveau ce qui avait surgi des sources mêmes de sa vie puisqu’il sait maintenant que « ne nous sont vraiment advenus que les événements que nous étions capables de souhaiter ». Mais cela ne sera pas morne répétition, ressassement stérile. Vouloir de nouveau, ce sera vouloir du nouveau, et remettant la mort à sa place, ce sera faire triompher la vie dans la mesure où notre être véritable n’est pas, caché, derrière nous, mais toujours à venir car « né avec nous, dit Bousquet, nous n’avons jamais été lui pleinement »:
Dans cette tourne qui du corps mène au cœur, Bousquet va ainsi s’accompagner lui-même et « faire cortège à ses sources », comme le demandera plus tard René Char, sources qu’il ne situait pas non plus en un quelconque amont mais bien au contraire « en aval », là-bas, devant, ailleurs, toujours ailleurs. De là peut-être cet aspect chancelant qu’à son œuvre dans les dix dernières années de sa vie – on sait son écriture en crue inondant de multiples cahiers que leur couleur différenciait du noir au saumon en passant par le bleu, le blanc… , et chanceler c’est zigzaguer aussi bien, et zigzaguer n’est pas hésiter mais bien multiplier les points de vue sur les lignes frontières afin de se rendre proprement insaisissable, et en « contrebandier », en « bandit des lettres », comme il aimait à l’écrire de lui-même, enfin passer.
J’appellerai Poésie, ce moyen de remonter à la vie, de « retourner à la vie (…) d’explorer la vie par ce que la vie a de plus invécu, de moins usé, de moins recraché (…) l’exploration de la vie par la vie qui n’a touché à rien, c’est une voie directe vers l’humain, vers de l’humain en formation ».
Le natal est son lieu, celui de toutes les naissances à venir !
Alain Freixe / Extrait de « Les Blessures de Joë Bousquet 1918-1939 » éditions Trabucaire 2018
1-S’il sut la traduire, c’est dans la mesure où « l’œuvre du poète est, selon lui, issue de son être éthique. »
2-Le paradoxe de mon propos est que je pense qu’il en va bien ainsi, mais que l’essentiel, pour être dit, n’en reste pas moins entaché soit de quelque erreur ou oubli, soit n’évite pas toujours le risque de quelque abstraction. Pire, peut-être, cet essentiel n’est jamais ancré dans son véritable lieu, lequel ne fait que répéter dans un nouveau montage, provoquant de nouvelles résonances, la blessure du 27 mai 1918, blessure perdue, tant il est vrai que les effets d’un acte ne se déroulent pas sur le plan de l’acte lui-même, qui d’ailleurs ne survit jamais à l’instant où il s’effectua.
3-Mon hypothèse est que cet essentiel, soit cette réponse à la question « qu’est-ce que prendre la taille d’un homme?, n’est pas lié à la blessure qui jeta Joë Bousquet dans les bras de la « ramasseuse de sarments », le condamnant « à vivre intolérablement dans sa propre mort » durant quelque trente ans, mais que cette blessure pourrait bien n’être que le précurseur, finalement invisible, de l’autre, celle qui fulgura dans la semaine qui suivit la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, comme l’éclair – cette remontée de lumière – est toujours précédé de sa trace sombre.
4-La seconde, « La poésie (…) entre dans l’accident pour en faire source de vie ».
5-« La vie est vérité. Traversée jamais achevée au terme de laquelle on reçoit son être véritable ».
7-« J’ai acquis quelques certitudes : l’homme n’est pas l’enfant de sa mère mais de sa vie : et il doit s’attacher à en déchiffrer le langage, en faisant parler les faits et en les traduisant dans sa propre langue, ou bien, conservant à ces événements leur caractère admirable ; et choisissant celui qui doit être, par le poète, dégagé de son humanité. » (Mystique)
9-« Je vivrai jusqu’à ma dernière heure l’instant de ma blessure, ou plutôt l’instant où j’acceptais ma blessure (…) On fait sa vie au lieu de la subir. Aimer la vie. » (Mystique)
10-« L’accident qui mutile un homme ne touche pas aux sources de son existence ; il n’est mortel qu’à ses habitudes et n’atteint de la vie que les chaînes qu’elle avait serrées sur ses jours. L’infortune physique ne corrompt que ce qui était à corrompre. » (Mystique)
11-« Nous ne lisons dans un fait que son contenu manifeste, nous méconnaissons qu’il est la conscience d’une vie où nous sommes à peine des ombres. »
12-« »Les faits n’ont pas à recevoir de nous une définition, ce qui est tuer la vie d’où ils viennent. Non, les faits nous définissent, c’est pourquoi les traduire, cela sera faire œuvre de vie. »
13-« Les événements ont leurs voies : nous ne les créons pas, ils nous créent. »
[1] Les adresses à Jean Ballard dans cet article sont toutes extraites de la correspondance Bousquet/ Ballard conservée aux Archives de la ville de Marseille.

