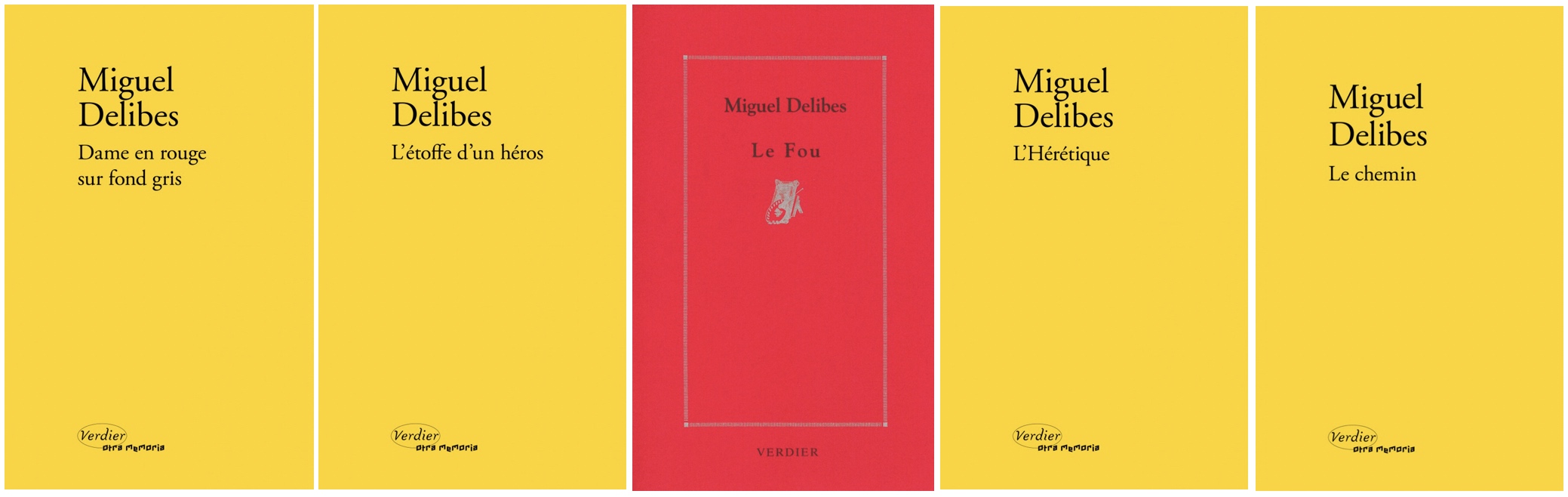UN SIÈCLE D’ÉCRIVAIN : MIGUEL DELIBES
Le 13 mai de l’an 2000, dans la belle collection de France 3 dirigée par Bernard Rapp, le portrait de Miguel Delibes dévoilait au grand public la vie et l’œuvre du grand écrivain espagnol.
En cette année du centenaire de sa naissance, nous vous proposons de revoir, en six épisodes, ce film documentaire.
Miguel Delibes, trilogie rurale…
3-LES SAINTS INNOCENTS
Ce roman à l’écriture singulière est le troisième volet de la trilogie. Publié en 1989, une trentaine d’années après Le chemin et Les rats, il n’en continue pas moins l’exploration implacable d’un monde cruellement inégalitaire. Paru alors que la démocratie en Espagne est définitivement établie, mais alors que la question de l’héritage de la dictature est toujours en suspens, le roman se rapporte à la société rurale des années 50-60, une période qui peut être à la fois précisément datée par bien des aspects mais qui par bien d’autres, comme dans presque toutes les œuvres de Delibes, est intemporelle comme l’est l’oppression des plus démunis.
Ce sont en effet divers modes d’oppression qui se mêlent pour emprisonner les protagonistes dans une vie misérable. L’action se passe dans un grand domaine d’Extrémadure, propriété de la Marquise qui ne réside pas sur ses terres et ne rend visite à « ses » paysans qu’à des occasions particulières. Elle leur distribue alors encouragements et remontrances dans un rapport aristocratique distant avec ses serviteurs qu’elle traite comme des enfants. C’est son fils, le señorito Iván, qui incarne vraiment la violence d’un pouvoir sans partage, secondé par don Pedro, le Régisseur, qui, même s’il adopte les manières d’une classe moyenne, n’en est pas moins, lui aussi, la propriété de son maître. Celui-ci le lui rappelle à chacune de ses apparitions, par une humiliation suprême : au vu et au su de tous les gens à son service, il « rend visite » à la femme du Régisseur.
Le señorito s’intéresse peu à ses terres. Son unique passion est la chasse. La chasse en compagnie qu’il exerce avec les notabilités qui font partie de son monde, du Gouverneur au Ministre lui-même. C’est Paco le Petit, le chef de la famille de paysans qui travaille ses terres qui lui a tout appris. Aussi, une fois devenu adulte, le considère-t-il comme corvéable à merci en période de chasse. Et Paco le Petit, flatté d’être présenté à ce beau monde comme la crème des limiers, ne peut qu’accepter de suivre son maître partout et en toute circonstance. Il voit s’envoler son rêve d’envoyer ses enfants à l’école pour leur permettre de sortir de cet esclavage. Leur destin tout tracé est de rester au service du domaine.
Paco et la Régula, son épouse, ont deux garçons, une fille, et puis la Charito, qu’ils appellent la Petite Gosse, bien qu’elle soit l’aînée, parce qu’elle n’a jamais grandi, qu’elle ne parle pas, ne marche pas et pousse à tous moments des hurlements à fendre l’âme. Ils sont bientôt rejoints par l’Azarías, le frère de la Régula, un innocent dont son señorito ne veut plus. Toute la journée, il ramasse la merde des troupeaux pour fumer les géraniums puis il pisse sur ses mains pour soigner ses gerçures. Mais sa passion à lui, ce sont les oiseaux qu’il élève et en particulier un hibou qu’il prend pour une busarde et qui finira par mourir. Son neveu lui donne alors une petite corneille encore sans plumes dont il s’occupe amoureusement. Une fois adulte, elle commence par lui échapper pour enfin revenir vers lui et se poser sur son épaule pour ne plus le quitter. Alors l’innocent voit à nouveau en elle la busarde perdue et il ne l’appelle et ne la présente aux autres que comme sa « busarde jolie ! » Une incantation qui, à l’instar du hurlement inhumain de la Charo, la Petite Gosse, traverse tout le roman comme un leitmotiv déchirant.
Le drame viendra de l’accident de Paco le Petit, forcé par le señorito à en faire toujours plus, il se casse la jambe en tombant d’un arbre. Ne pouvant se passer de lui, son maître refuse qu’il soit soigné correctement et qu’il se repose. Quitte à le rendre définitivement infirme, il le force à préparer une partie de chasse qu’il a promise à des invités prestigieux. Paco rechute. Ne pouvant plus se relever, il fait appel à son fils qui ne montre aucun empressement à servir un maître qu’il ne reconnaît plus comme tel. En désespoir de cause, le señorito fait appel à l’Azarías, l’innocent, qui tente tant bien que mal de comprendre ses consignes. Mais entre le chasseur que seule la prédation intéresse et l’amoureux des oiseaux tout est brisé d’avance. Le señorito ne supportant plus la présence de la corneille que l’innocent prend pour une busarde, la tue d’un coup de fusil, scellant ainsi son destin. Ce que n’auraient jamais osé ni le serviteur dévoué constamment humilié ni le jeune fils de paysan rêvant d’une autre vie, c’est l’innocent qui le réalise.
Une fois son geste vengeur accompli, l’Azarías mâcha sa salive, sourit « bêtement au ciel, au néant, busarde jolie, busarde jolie, répétait-il machinalement, à cet instant un vol serré de tourterelles agita l’air en rasant le faîte du chêne-liège dans lequel il se cachait. »
Francisco Umbral a souligné que le roman décrit bien « une oligarchie rurale avec des restes de féodalité, quelque peu manichéen » mais le monde de Delibes est un monde où la justice, où la rébellion contre les injustices de l’oligarchie ne vient pas d’un collectif, du peuple, comme dans bien des œuvres littéraires mais de la main d’un ‘innocent’, d’un ‘idiot’, d’Azarías qui pend le señorito Iván à un arbre parce qu’il a tué sa busarde d’un coup de fusil. Sans doute le tyran paye-t-il ainsi pour tous les abus commis, mais la subtilité de Delibes consiste à les concentrer dans la mort banale et gratuite de l’oiseau et en laissant la vengeance à l’initiative de l’innocent Azarías. C’est ce que j’appelle une justice poétique. »
Mario Camus, qui a suvi le plus souvent à la lettre dans son film le texte et les dialogues du roman, adopte cependant, pour parler de l’oeuvre, un ton plus radical : « Les saints innocents traite d’oppresseurs et d’opprimés, de dominants et de dominés, et je crois que cela existe en tout lieu et que, de plus, cela existera toujours. Cela ne peut changer qu’avec une révolution qui renversera totalement les choses ». Delibes, qui appréciait beaucoup le film, répond laconiquement à propos de deux épisodes qui n’étaient pas dans le livre : « Camus a apporté ses propres idées, une histoire inventée par lui : la rédemption sociale. Dans son film, Nieves et le Quirce [deux enfants de Paco et de la Régula] ont été contraints de s’intégrer totalement à la société industrielle. Nieves travaille dans une usine et le Quirce dans un atelier de mécanique automobile. Le scénario de Camus tire l’histoire vers notre actualité ».
Les Saints Innocents : extrait
Il y avait eu une sacré dispute à la Grande Maison pendant le déjeuner, au dire de la Nieves, à propos de la culture, le señorito René disait qu’en Europe centrale, c’était un autre niveau, une énormité voyons, même que le señorito Iván,
ah, c’est ce que tu penses René, mais ici, il n’y a plus d’analphabètes, tu crois qu’on est encore en 36 ?
le ton monta, tous deux se mirent à crier, jusqu’à en perdre les bonnes manières et à se manquer de respect, alors, le señorito Iván, exaspéré, fit appeler Paco le Petit, la Régula et le Ceferino,
c’est stupide de discuter, René, tu vas le voir de tes propres yeux,
hurlait-il,
quand Paco et les autres se présentèrent, le señorito Iván adopta le ton didactique du señorito Lucas pour dire au Français,
regarde, René, à dire vrai, dans le temps, ces gens étaient analphabètes, mais maintenant tu vas voir, Paco, prends ce stylo et écris ton nom, s’il te plaît, mais écris-le bien, applique-toi,
un sourire tendu se dessinait sur ses lèvres,
c’est la dignité nationale et rien d’autre qui est en jeu,
toute la table était suspendue aux gestes de Paco, le pauvre, et don Pedro, le Régisseur, se mordit la joue et posa sa main sur l’avant-bras de René,
que tu le veuilles ou non, René, depuis des années dans ce pays, on fait tout ce qui est humainement possible pour libérer ces gens,
le señorito Iván,
chut, ne le distrayez pas, crispé par le silence expectant, Paco le Petit traça un gribouillis au verso de la facture jaune que le señorito Iván lui avait posé sur la nappe, il y mettait ses cinq sens, enflait les ailes de son nez épaté ; quand il eût terminé, il se redressa, rendit le stylo au señorito Iván et celui-ci le donna au Ceferino,
toi, maintenant, Ceferino,
ordonna-t-il,
ce fut au tour du Ceferino, tout effrayé, il se pencha sur la nappe et traça sa signature ; à la fin, le señorito Iván s’adressa à la Régula,
maintenant, c’est à toi, Régula
puis, se tournant vers le Français,
ici on ne fait pas de différence, René, ici il n’y a pas de discrimination entre mâles et femelles, comme tu peux le vérifier,
d’une main hésitante, car le stylo glissait sur son pouce aplati sans empreintes digitales, la Régula écrivit péniblement son nom, mais le señorito Iván qui discutait avec le Français ne remarqua pas les difficultés de la Régula, et dès qu’elle eut terminé, il lui prit la main droite et l’agita à plusieurs reprises, comme un drapeau,
vois-tu ?
dit-il
pour que tu ailles le raconter à Paris, René, vous autres les Français, vous nous faites un mauvais procès, cette femme, si tu veux le savoir, il n’y a pas longtemps, elle signait encore avec son pouce, regarde !
et en disant cela, il écarta le doigt déformé de la Régula, plat comme une spatule ; confuse, la pauvre devint toute rouge, comme si le señorito Iván la montrait toute nue debout sur la table, or René ne prêtait pas attention aux paroles du señorito Iván, il regardait avec perplexité le doigt aplati de la Régula, et quand il se rendit compte de son étonnement, le señorito Iván expliqua,
ah, oui ! ça c’est une autre histoire, les pouces des vannières sont comme ça, René, c’est les inconvénients du métier, les doigts se déforment à force de tresser l’osier, tu comprends, c’est inévitable,
il souriait et se raclait la gorge, puis, pour en finir avec cette situation tendue, il se tourna vers ses employés et dit,
allez, vous pouvez vous sauver, c’est bien,
et comme ils marchaient vers la porte, la Régula, déconcertée, grommelait,
il en a de bonnes le senorito Iván,
et à table, tous d’éclater d’un rire paternel et indulgent, sauf René, dont le regard s’était obscurci, il ne souffla plus mot.
[Traduit par Rudy Chaulet, Les saints innocents, Verdier, p.71-73.]
Les Saints Innocents : la lecture de l’écrivaine Marie-Hélène Lafon
L’Azarías pue. Il pue la fiente de poule. Il pisse sur ses mains pour ne pas avoir de crevasses et sa bouche est sans dents. L’Azarías aime la busarde jolie, hibou ou corneille, il la caresse et la gratte entre les yeux, il la nourrit.L’Azarías aime aussi la Petite Gosse, fille première-née de sa sœur, la Régula. La Petite Gosse ne marchera pas, ne parlera pas, fera sous elle pour toujours et ne tiendra même jamais sa tête. Parfois la Petite Gosse crie ; elle crie, et une terreur sans nom remonte du fond des âges. Mais l’Azarías ne craint pas la Petite Gosse et il lui gratte avec insistance les cheveux derrière la tête. L’Azarías et la Régula sont frère et sœur, ils tiennent l’un à l’autre et tâchent de se tenir à leur place qui est celle des écrasés. Les écrasés de la terre castillane sont sans mots. Ils servent sous la férule des maîtres ; ils leur appartiennent, à l’égal des bois, des terres, des bêtes, des maisons. Ils ploient sous leurs désirs impérieux et s’appliquent même à déchiffrer l’alphabet quand madame la marquise entreprend d’éradiquer l’analphabétisme dans la propriété. Les écrasés existent dans le sillage des maîtres et trouvent que madame est bien bonne pour les pauvres. Mais le vent se lèvera et le señorito Iván récoltera la tempête qu’il a semée ; le señorito Iván n’aurait pas dû tirer sur la busarde jolie. Il n’aurait pas dû.
Marie-Hélène Lafon